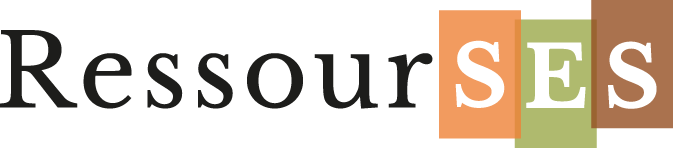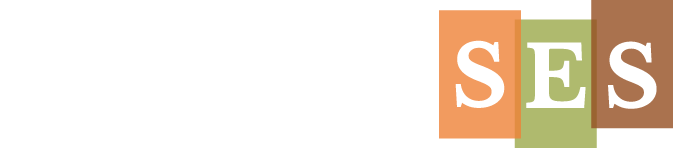Pierre Boyer est professeur à l’École Polytechnique et au Centre de recherche en économie et en statistique (CREST) et il nous propose un ouvrage court sur une question insuffisamment abordée, celle du consentement au paiement de l’impôt. Celle-ci est aujourd’hui centrale par les liens qu’elle entretient avec le maintien ou la transformation de notre système social mais aussi parce que le financement inévitable de la transition écologique va la rendre nécessaire. Le cœur du livre est donc de rendre compte et mesurer ce consentement à l’impôt et surtout de faire des propositions pour l’améliorer.
Thierry Rogel
Professeur de SES
L’auteur ne cherche pas à toucher les spécialistes de la question (ou même les spécialistes en sciences sociales) mais le « grand public ». En témoignent la brièveté du texte (autour de 100 000 signes ce qui en fait un « gros article »), le choix d’une langue aisément compréhensible et surtout les rappels pédagogiques réguliers[1]. Ainsi, il consacre quelques pages à faire des rappels nécessaires sur les différences entre impôts, cotisations sociales et prélèvements obligatoires.
Son premier constat est l’existence d’un paradoxe entre le discours ambiant dans lequel les Prélèvements Obligatoires sont décriés et mal vécus (« allergie fiscale », « fardeau fiscal », etc.) et les corrélations mises en évidence entre le fait que les nations où on est satisfait de la vie menée (selon notamment les sondages du « World Hapiness Report ») sont des nations où la pression fiscale est forte. Ceci se vérifie aussi bien quand on compare les pays selon leur degré de développement que lorsqu’on fait une comparaison au sein des pays développés eux-mêmes (cependant il est possible qu’à même pression fiscale la satisfaction ne soit pas la même dans deux pays). Paradoxe également avec le fait que l’impôt est au cœur du pacte républicain (l’auteur mentionne trois articles tirés de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789). Troisième paradoxe avec le fait que si globalement le discours sur l’imposition est négatif, des nuances apparaissent suivant l’échelle à laquelle on s’intéresse. Ainsi, si 75 % des Français pensent que les impôts en général sont trop élevés ils ne sont plus que 65 % à le penser pour les impôts qu’eux-mêmes paient. Dernier paradoxe : 80 % des Français estiment que le paiement de l’impôt et des cotisations sociales est un acte citoyen !
Il apparaît donc comme indispensable de comprendre la « mécanique » du consentement à l’impôt. Pour l’auteur, il est nécessaire de comprendre tout d’abord que le « consentement à l’impôt » peut renvoyer à deux phénomènes différents : ce qu’il appelle le « civisme fiscal » – on paie l’impôt quoi qu’on pense de celui-ci – et « l’acceptation politique de l’impôt » – l’adhésion idéologique et politique au système fiscal tel qu’il existe.
En bon pédagogue, l’auteur fait également le point sur les systèmes fiscaux et parafiscaux des États-Unis, du Danemark, de la France et de l’Allemagne ainsi que sur leurs dépenses publiques. Il fait également un rappel sur les évolutions de la fiscalité et leurs effets structurels, ce qui permet à Boyer de dire que les diverses générations ont vécu dans des environnements fiscaux différents (ce qui a bien entendu des répercussions sur le consentement).
Pour l’auteur, la question de l’acceptation de l’impôt sera particulièrement importante par rapport à deux défis à venir. Premièrement, face aux transformations de la famille, Boyer pose la question de la probable nécessité à venir de passer d’un système d’imposition fondé sur les foyers à un système individualisé. Mais il va surtout falloir faire accepter les futures impositions liées à la transition écologique. Or, celles-ci cumulent l’ensemble des obstacles qui rendent le consentement difficile (comme l’ont illustré les épisodes des Bonnets rouges en 2013 et des Gilets jaunes en 2018) : la fiscalité carbone pèse sur les ménages les plus modestes et sur des dépenses souvent incompressibles ; de plus, l’exemption de certaines entreprises peut amener certains citoyens à se questionner sur l’équité de telles mesures. Enfin, on peut craindre une concurrence déloyale si tous les pays n’adoptent pas les mêmes mesures.
Quels sont les fondements du consentement à payer l’impôt ? L’auteur en distingue sept et en retient trois particulièrement importants.
Le sentiment d’équité est central mais ce sentiment peut être très différent d’une personne à l’autre. Absolument essentielle est la satisfaction liée aux dépenses publiques, l’insatisfaction pouvant être liée soit à un sentiment de gaspillage soit à un désaccord quant à l’affectation des dépenses publiques. Les Français sont donc prêts à payer s’ils estiment que leur « argent est bien employé », ce que montrent divers sondages et une expérimentation psychosociale rapportée par l’auteur où on montre à un groupe une vidéo détaillant le contrôle par la Cour des comptes de l’utilisation de l’argent public.
Cela nous amène au troisième pilier du consentement qui est la bonne compréhension et la bonne connaissance du système fiscal et parafiscal (y compris des dépenses publiques). Boyer signale que lorsque l’on demande aux français quels sont les premiers mots qui leur viennent à l’esprit quand on leur parle de « prélèvements obligatoires » (PO), la majorité ne pense rien. De plus les réponses à quelques questions simples montrent l’importance des lacunes (situer le niveau des PO entre 40 et 49 % du produit intérieur brut ‒ PIB ‒, savoir que la contribution sociale généralisée ‒ CSG ‒ et que la taxe sur la valeur ajouté ‒ TVA ‒ sont supérieurs à l’impôt sur le revenu) : seuls 5 % des interrogés répondent correctement aux trois questions, 29 % à deux question et 35 % à une seule (donc 31 % ne répondent correctement à aucune des questions ou ne répondent pas du tout).
Les autres fondements du consentement sont ensuite la confiance dans les institutions (et dans les autres) ; les travaux de Cahuc et Algan (La société de défiance, 2007) ont permis de savoir combien celle-ci est faible en France. Viennent égalent les relations avec l’administration fiscale et l’intolérance à la fraude (en revanche, je suis surpris que l’auteur ne retienne pas le caractère plus ou moins visible d’un prélèvement).
Cet ouvrage est simple à lire et peut être mis dans les centres de documentation et d’information (CDI) et entre les mains des élèves les plus intéressés. Il peut également nourrir les cours des enseignants de sciences économiques et sociales (SES) : la transition à faire du livre au cours est assez aisée. Il permettra surtout de combler les véritables béances du programme officiel sur la question des prélèvements et des dépenses publiques (deux mentions au maximum en première contre trois chapitres consacrés au marché). De même, il met en avant un des impensés du programme officiel qui ne voit que l’innovation comme réponse à la question du changement climatique : il faudra en effet pour cela une intervention des pouvoirs publics et probablement de nouveaux prélèvements. Or, comment faire pour que la population y consente ?
Enfin, l’auteur indique qu’il est obligé d’aller au-delà de la seule démarche économique qui l’aurait cantonné aux questions de l’efficacité des prélèvements et de leur équité. Laissons-lui la parole : « Plus généralement, tenter de comprendre le consentement à l’impôt nécessite une grille de lecture qui intègre les derniers résultats de la recherche dans différentes disciplines (Droit, Économie, Histoire, Psychologie, Sociologie, Science Politique, …). Dans la lignée de l’évolution des dernières décennies des sciences économiques vers plus d’interdisciplinarité, nous allons nous attacher à mener notre analyse avec cette ambition dans les pages qui suivent » (p. 31). Parlant d’interdisciplinarité, il semble clair qu’il ne compte pas « juxtaposer » les disciplines mais bien les entrecroiser dans une même réflexion. Beau plaidoyer pour les « SES à l’ancienne », celles que nous défendons majoritairement.
Notes
[1] Pour les lecteurs qui aimeraient approfondir la réflexion, il renvoie à l’intégralité des documents statistiques utilisés dans le livre sur son site (https://pierrecboyer.com)
Bibliographie
Algan Y., Cahuc P., 2007, La société de défiance : Comment le modèle social français s’autodétruit, Paris, Éd. ENS rue d’Ulm.