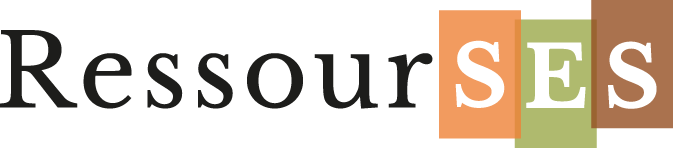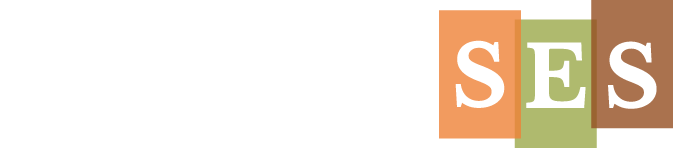Dans cet article, j’explore les conditions de félicité du métier d’enseignant à travers la notion d’« enchantement ». Je propose de remplacer la logique dispositionnaliste, habituellement utilisée dans les études sociologiques sur le sujet, par la logique dispositive. Mon objectif est ainsi de démontrer que l’ordinaire des enseignants repose sur des éléments socio-matériels cruciaux pour l’exécution de leur pratique quotidienne. À l’aide d’un court exemple ethnographique tiré de mon expérience de formateur d’enseignant, je cherche à montrer combien la possibilité même de développer un sentiment de bien-être et de bonheur au travail est corrélatif de ces agencements infrastructurels.
Edgar Tasia
Professeur associé, didactique des sciences sociales
OMER, Université de Liège
Introduction
Dans le cadre d’une visite de stage, je me rends dans un établissement scolaire de la communauté française de Belgique, situé dans la province de Liège. Dans la salle des professeurs, j’attends, avec ma stagiaire, l’arrivée de sa maîtresse de stage.
Cette dernière, Madame S., arrive et informe ma stagiaire de la nécessité d’imprimer son support de cours avant d’aller en classe. Les photocopieuses (au nombre de deux) se trouvent de l’autre côté de la cloison de la salle ; nous nous y rendons ensemble.
L’endroit est vide, ce qui a fait dire à Madame S. : « Eh bien, on a de la chance ! » L’étudiante dispose d’une version digitale de son support de cours sur une clé USB ; elle la tend à Madame S. pour qu’elle puisse régler les paramètres techniques de la machine et lancer l’impression. Jusque-là, tout se passe bien : la stagiaire, un peu nerveuse de devoir présenter sa leçon devant moi (son examinateur), reste néanmoins joviale et relativement détendue. Cependant, le document qui sort de la machine ne correspond pas à ce qui est attendu. Madame S. déclare : « Sans doute une erreur de sélection du fichier [sur la clé USB]. Ce n’est rien, on va recommencer. » Elle répète l’opération, mais une fois de plus, le résultat n’est pas celui attendu : le document craché par la machine n’est pas celui préparé par la stagiaire. Le temps passe, la récréation touche à sa fin — le niveau de stress de la stagiaire et de Madame S. devient palpable.
Madame S. sort alors son propre ordinateur portable de sa serviette et l’allume. Elle branche la clé USB sur ce dernier, puisque l’établissement ne dispose pas d’une console ou d’un moniteur prévu à cet effet. Ensemble, penchées sur l’écran, Madame S. et la stagiaire veillent à sélectionner le bon document ; elles le vérifient en ouvrant le fichier sur l’ordinateur. Tout semble correct. Madame S. répète l’opération déjà tentée deux fois auparavant et ordonne à la machine d’imprimer le document. Une fois de plus, le résultat est décevant.
La stagiaire, maintenant paniquée, me demande : « Que faire si ça ne marche pas ? » Madame S. la rassure en disant : « Ça va marcher, t’inquiète », tout en s’affairant. Elle suggère d’essayer l’autre photocopieuse, « plus capricieuse, mais on ne sait jamais ». Nouvel essai, nouvel échec. Je propose alors mon aide en sortant aussi mon ordinateur portable pour vérifier la qualité du fichier. Je branche la clé USB, consulte le fichier en question. Je ne remarque rien d’anormal et, après avoir parcouru à nouveau le document, j’exporte le fichier en format .pdf, comme l’avait déjà fait Madame S. Revenant sur la première photocopieuse, l’enseignante tente une fois encore d’imprimer le document — tentative qui s’avère être une fois encore infructueuse. De plus, un bourrage papier se déclare. Rapidement, Madame S. résout ce problème en chipotant à la machine. La sonnerie retentit, indiquant le début du cours. Nous nous regardons, la stagiaire, Madame S. et moi-même, anxieux et embêtés. Que faire de plus ?
Dans un ultime effort, après avoir refait le chemin entre son ordinateur, la clé USB et l’imprimante, Madame S. tapote sur le cadran de la photocopieuse et appuie une fois de plus sur le gros bouton vert pour lancer l’impression. Cette fois-ci, miracle, cela fonctionne correctement. Tout le monde se détend. Il ne reste plus qu’à copier le document une quinzaine de fois, puis à nous rendre en classe, certes en retard mais avec le support de cours. En marchant rapidement vers la salle, les mains pleines de feuilles de papier fraîchement noircies, la stagiaire me murmure : « Que se serait-il passé si cela n’avait pas marché, hein ? »
Ce que tente d’illustrer cette vignette est bien banal ; c’est l’embarras routinier et quotidien du métier d’enseignant, ce professionnel de l’éducation aux prises avec son environnement direct — et notamment avec « l’infrastructure » (Bowker et Star, 2023) de l’école. Sur cette question, la littérature ethnographique d’orientation anthropologique est plutôt discrète[1] ; elle est cependant constante dans les résultats qu’elle présente : les conditions socio-matérielles de l’enseignement influencent et impactent la pratique du métier (De Meyer, 2024 ; Lawn et Grosvenor, 2005 ; Sørensen, 2009). En revanche, ce dont traite moins cette littérature, c’est l’importance existentielle de cette situation infrastructurelle pour les enseignants dans leur développement professionnel et identitaire[2].
Je souhaiterais m’intéresser ici à cet angle-mort en interrogeant les conditions de félicité du métier d’enseignant à l’aune de la notion d’« enchantement ». Pour ce faire, je tenterai de substituer la logique dispositive à la logique dispositionnaliste — généralement défendue dans les enquêtes sociologiques sur ce sujet. Partant, je tâcherai de montrer combien le routinier et le quotidien professionnels des enseignants se structurent à partir d’un en-deçà existentiel fragile, reposant sur des dispositifs socio-matériels primordiaux pour le développement d’un sentiment de bien-être, voire de bonheur, au travail.
Du « désenchantement » parmi les enseignants ?
Tenter de rendre compte du bonheur au travail, c’est, notamment, s’intéresser à la faculté qu’a une profession d’enchanter ou non ses travailleurs ; c’est, entre autres, mesurer la qualité d’illusion génératrice de bien-être que provoque — peu ou prou — une activité professionnelle chez ceux qui la pratiquent. A contrario, s’intéresser au processus de désenchantement d’une catégorie professionnelle, comme celle des enseignants, c’est se pencher sur les raisons d’un constat, lui-même prenant la forme d’une tendance : celle de l’apparition d’une absence ou d’une diminution du bonheur ressenti au travail.
Dans son dernier ouvrage intitulé Enseignants : de la vocation au désenchantement, Sandrine Garcia (2023) s’intéresse à un tel processus. Elle y note combien celui-ci, poussant de nombreux enseignants à démissionner, est fortement conditionné par le « contexte de travail », c’est-à-dire par la mauvaise qualité des postes, des conditions d’exercice du métier ou encore du rapport difficile à la hiérarchie que l’on trouve aujourd’hui dans les écoles. Ainsi, nous dit-elle, « ce contexte de travail empêche la vocation par expérience, ou la confirmation d’un rapport vocationnel au métier » (Garcia, 2023, p. 37).
L’argument général développé par l’auteure est représentatif d’une grande part de la littérature sur le sujet (Gavillet-Mentha, 2011 ; Lahire, 2018 ; Perez-Roux, 2006). Je voudrais cependant en interroger le postulat théorique. En effet, ce renversement de point de vue — consistant à s’intéresser d’abord au processus de désenchantement qui touche les enseignants avant d’étudier la question de leur potentiel enchantement — n’est pas anodin ; il est la suite logique d’un postulat théorique non-interrogé : celui d’un allant-de-soi des conditions de félicité potentielles d’un milieu professionnel. Pour éviter cet écueil, et nous laisser surprendre par ce que son dépassement pourrait nous apprendre sur le métier, il nous faut poser en amont de la question du désenchantement, celle de l’enchantement des enseignants. Sur quoi pourrait donc reposer un tel émerveillement professionnel pour ces derniers ?
D’une sociologie dispositionnaliste à une sociologie dispositiviste
Dans l’ouvrage susmentionné, Garcia propose une lecture du phénomène de « désenchantement » des enseignants relativement classique : son argumentaire repose en effet sur une compréhension dispositionnaliste de la vocation (2023, p. 33-37), elle-même directement inspirée de la définition qu’en donne Bernard Lahire dans son article Avoir la vocation (2018). Dans ce texte, le sociologue français définit la vocation comme un « sentiment » qui « souligne la correspondance parfaite ou l’adéquation totale entre la personne et l’activité, le métier ou la fonction » (Ibid., p. 143). Autrement dit, pour Lahire, le sentiment de vocation émerge de la collusion « parfaite » entre d’une part, le passé incorporé de l’individu — ses dispositions — et, d’autre part, le milieu professionnel — le contexte — dans lequel ces dispositions viendraient se déployer. Ainsi, ajoute-t-il, c’est bien cette « adéquation totale », qui déclenche « l’adhésion enchantée des personnes à l’activité qu’elles exercent » (Ibid., p. 144).
L’argument dispositionnaliste d’un sentiment « enchanté » résulte donc de la rencontre appropriée, quasi miraculeuse, entre le contexte et les dispositions de l’individu (voir Lahire, 2007 ; Bourdieu, 1980). Si cette perspective théorique rend bien compte des divers processus dispositionnels d’incorporation qui permettent à l’individu de se sentir ainsi (inconsciemment) pleinement ajusté au contexte dans lequel il se trouve immergé, elle laisse cependant dans l’ombre un ensemble d’éléments — socio-matériels — qui, au quotidien, contribuent à rendre ce contexte aménageable, malléable et donc, in fine, potentiellement appropriable. En effet, en supposant un individu « agent » et non acteur, la sociologie dispositionnaliste se prive de penser la possibilité, pour le contexte ou la situation, d’être travaillée par l’individu. C’est qu’entre les deux éléments constitutifs de l’équation pratique dispositionnaliste[3], les sociologues qui s’appuient sur cet appareillage théorique tendent à ne rendre compte que du premier. Ce faisant, ils négligent souvent, dans leurs analyses, la dimension éco-logique du contexte et, partant, le pouvoir sociologiquement organisateur de la « niche » qu’il constitue pour les individus (Saarinen et Krueger, 2022). Cette sociologie semble en effet sous-estimer l’importance des boucles de régulation à la fois cognitives (Hutchins, 1995) et affectives (Krueger, 2015) qu’autorise la manipulation, de leurs espaces directs et de la matérialité qui composent ceux-ci, par les acteurs.
Pour pallier ce déficit théorique et tenter d’approcher à nouveaux frais la question de l’enchantement du métier d’enseignant, il est donc nécessaire d’opérer une réorientation théorique : laisser de côté l’approche de la sociologie dispositionnaliste et nous tourner vers une autre, plus à même de rendre compte de cette dimension écologique du contexte, ainsi que de sa plasticité. Parce que ce que nous chercherons ici à saisir se situe en deçà des dispositions, c’est ce qui, en dehors du corps de l’individu, conditionne leur structuration — la matérialité du contexte donc — qui nous intéressera. Dans cette entreprise délicate, les travaux d’Emmanuel Belin sur la logique dispositive nous seront d’une aide précieuse.
Vers une théorie de l’enchantement de l’ordinaire
D’un enchantement l’autre
La question de l’enchantement, depuis les travaux précurseurs de Max Weber (2017 [1905]) et d’Émile Durkheim (2012 [1912]) a donné lieu à de nombreuses études d’orientation socio-anthropologique (Halloy et Servais, 2014 ; Brahy, Bourgeois et Zaccaï-Reyners, 2020 ; Brahy, 2023). Ces dernières, de manière plus ou moins uniformisée, ont cherché à saisir les conditions de possibilité et de félicité de cette expérience — subjective aussi bien que collective selon le cas étudié — du merveilleux (Susswein et Tasia, 2020). Au sein de cette tradition disciplinaire naissante, qui s’inscrit généralement dans la lignée théorique ouverte par Yves Winkin (2001), l’enchantement correspond à un concept heuristiquement fécond visant à saisir l’extra-ordinarité de situations « au sein desquelles des acteurs se conforment à des règles tacites auxquelles ils pourraient aisément se dérober ou s’opposer » (Brahy, Bourgeois et Zaccaï-Reyners, 2020). La mécanique sociale de l’enchantement est ainsi résumée à une « suspension volontaire de l’incrédulité » (Ibid.) pouvant être sociologiquement étudiée et comprise au moyen des outils classiques de la discipline.
Si cet usage de la notion d’enchantement semble pertinent pour bien des cas, celui-ci laisse cependant dans l’ombre tous ces autres cas qui, comme « en négatif », se révèlent à lui par son opérationnalisation : les cas ordinaires. Le sociologue Emmanuel Belin (2002) a développé une autre approche de l’enchantement en s’intéressant notamment au principe d’illusion nécessaire garantissant non pas la réussite de l’expérience extra-ordinaire mais celle de l’expérience banale. Pour lui, l’ordinarité du quotidien — sa normalité et sa fluidité dés-angoissées — n’est pas assurée d’emblée : elle résulte d’un travail d’aménagement et de structuration de notre milieu, assurant la bonne rencontre du subjectivement conçu et de l’objectivement perçu. En prenant comme point de départ les travaux du pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott, Belin développe une sociologie des « espaces potentiels » qui cherche à capturer ce qui rend l’ordinaire possible. Pour saisir la fécondité des thèses de Belin pour notre enquête, un détour par la compréhension de celles de Winnicott est donc nécessaire.
Vers une anthropologie de l’expérience ordinaire
Chez Winnicott, l’espace potentiel est cette zone intermédiaire, située entre la mère et le petit enfant. Un tel espace s’inscrit dans un principe psychologique d’illusion permettant à l’individu en devenir de négocier la transition, la frontière, entre lui-même et son environnement (Davis et Wallbridge, 2016, p. 63). Mais Winnicott ne cantonne pas au seul couple nourrisson-mère la nécessité d’un tel espace : il l’élargit à l’ensemble de l’humanité et en vient ainsi à proposer « une théorie de la vie quotidienne » (Belin, 2002, p. 63) permettant de comprendre « l’activité de fabrication de signification, reposant sur un rapport créatif avec les objets issus du réel ou de l’imaginaire de l’autre, et établie dans un cadre rassurant » (Ibid., p. 113). Ce faisant, c’est une véritable anthropologie de l’expérience ordinaire « où s’opère la transaction sociale, où trouvent à s’installer les figures de l’intersubjectivité humaine » (Ibid., p. 64) que développe le pédiatre anglais. En effet, comme ce dernier le déclare lui-même, « nous supposons ici que l’acceptation de la réalité est une tâche sans fin et que nul être humain ne parvient à se libérer de la tension suscitée par la mise en relation de la réalité du dedans et de la réalité du dehors ; nous supposons aussi que cette tension peut être soulagée par l’existence d’une aire intermédiaire d’expérience, qui n’est pas contestée (arts, religions, etc.) » (Winnicott, 1975, p. 47).
Les implications anthropologiques de la thèse de Winnicott sont importantes. D’abord, car elles permettent une nouvelle mise en tension du rapport dialectique réalité/imaginaire et autorise ainsi à en dépasser la stérile dichotomie par une proposition synthétique originale : celle d’une zone, d’un espace intermédiaire où, véritablement, l’homme vivrait — le « lieu où nous vivons » (Winnicott, 1975) —, composée d’un fragile mélange de productions internes et de perceptions externes. Ensuite, car elles posent le raté comme un possible, le chaos et l’angoisse comme une possibilité de l’expérience humaine[4]. Enfin, car les propositions de Winnicott impliquent une nécessité : celle d’un travail important permettant la saine et sécurisante constitution de cet espace, celle d’une « tâche sans fin » mobilisant d’autres ressources que les seules dispositions de l’individu.
Mais où donc trouver ces ressources extra-individuelles si ce n’est au-dedans de l’individu lui-même, « incorporées » en lui comme le postule (notamment) la sociologie dispositionnaliste ? C’est au milieu, à l’environnement, nous répond Winnicott, que va incomber le poids de cette prise en charge ; celui-ci va en effet jouer un rôle structurant, non pas au sens de « structures structurantes et structurées » incorporées, d’habitus donc (Bourdieu, 1980), mais plutôt en tant que soutien (holding) au développement de l’individu[5].
La logique dispositive
Une telle redéfinition de certaines coordonnées anthropologiques (le rapport réalité/imaginaire, individu/environnement, sécurité/angoisse, développement/soutien) de l’expérience ordinaire permet de faire basculer la perspective théorique de notre enquête, privilégiant, au choix initial de la sociologie dispositionaliste, une sociologie dispositiviste, c’est-à-dire une sociologie s’articulant autour de la logique dispositive (Belin, 2002), cherchant à prendre au sérieux l’hypothèse des espaces potentiels et qui s’intéresse à l’étude de tous ces dispositifs qui nous soutiennent, ces environnements socio-matériels qui permettent d’octroyer à l’ordinaire sa fluence et rendent ainsi possible ce que Belin nomme la déambulation (Ibid., p. 218). Une telle sociologie, en effet, cherche à analyser les « manières de faire ordinaires » (Ibid., p. 173), de « disposer » (Ibid., p. 174) des lieux ; elle tente d’articuler les rapports complexes entre l’individu, toujours en train de se (re)faire, et ce que Belin nomme des « dispositifs », ces « environnements ambigus » (Ibid., p. 172) qui participent à favoriser la rencontre du subjectivement conçu et de l’objectivement perçu. Comme le résume Belin lui-même, « [c]e que l’entourage humain de l’être immature pouvait garantir du fait de sa capacité d’illusionnement, c’est ici le dispositif qui s’en trouve mandaté » (Ibid., p. 234). Le dispositif, autrement dit, devient ce qui rend possible l’expérience ordinaire : il est « l’écrin expérientiel » (Ibid., p. 229) de cette dernière.
Et l’enchantement dans tout ça ? Celui-ci devient, dans ce cadre, un concept sociologique permettant de saisir la réussite de l’expérience ordinaire. En effet, en instaurant « un espace potentiel dans lequel le paradoxe [entre le subjectivement conçu et l’objectivement perçu] est toléré et où l’illusion de la bienveillance indispensable à l’établissement de la confiance peut prendre corps » (Belin, 2002, p. 232), le dispositif « déplace les maximums de vraisemblance du désordre, de l’étrangeté, vers l’ordre et la familiarité » (Ibid., p. 281), autorisant ainsi la douce surprise et le tranquille émerveillement à prendre corps. Dans ce cadre, l’enchantement devient de facto un outil sociologique capable d’évaluer la qualité du processus de mise en forme du quotidien (voir, à titre d’exemple, Tasia, 2023).
De l’enchantement parmi les enseignants ?
En insistant sur la primordialité de l’agencement socio-matériel des dispositifs qui nous entourent, la théorie dispositiviste se distingue de la perspective dispositionnaliste : d’après cette première approche, l’enchantement découle d’un en-deçà socio-matériel structurant « suffisamment bon ». En cela, elle invite à prêter attention aux différentes situations concrètes rencontrées par les acteurs, au sein même des écoles ; elle nous pousse à nous tourner vers les modes d’ordonnation chaque fois spécifiques de l’infrastructure scolaire afin d’y déceler leur dimension plastique, et donc leur capacité à échafauder ou non un milieu ordinaire (potentiellement enchanteur) pour les acteurs. Ainsi, c’est l’analyse des conditions proprement écologiques de l’environnement de travail des enseignants qui doit désormais nous préoccuper.
Revenons, pour exemplifier le principe d’une telle approche, à notre vignette ethnographique présentée au début de ce texte. Que s’y passe-t-il sinon une faillite — rattrapée de justesse, il est vrai — de la logique dispositive ? Que nous raconte l’expérience commune de cette maîtresse de stage et de cette stagiaire aux prises avec les deux photocopieuses défectueuses de cet établissement scolaire, sinon justement le quasi-échec de la mise en branle d’une expérience ordinaire — celle en l’occurrence de se munir du matériel dont on a besoin pour enseigner ? Bien que la littérature scientifique soit particulièrement silencieuse sur le rôle central (et anxiogène) de la photocopieuse dans la pratique du métier (voir Balcou-Debussche, 2007), tous les enseignants savent combien le passage par ce poste — celui de la photocopieuse, crucial pour le déroulement de la mission pédagogique qui leur est assignée, est fragile et périlleux : comme ce fut le cas dans le récit ci-dessus, les choses peuvent très vite devenir compliquées voire problématiques, et obstruer le bon déroulement de la journée. Si, en effet, le « miracle » n’advient pas (comme cela finit par être le cas dans le récit présenté), c’est toute la planification du travail à réaliser qui s’effondre ; c’est l’ensemble de la pratique qui est potentiellement empêché. Que nous apprend cet exemple sur l’ordinaire des enseignants ?
Trois enseignements
D’abord, que les ratés infrastructurels proches de celui décrit ici, sont banals, quotidiens et routiniers : potentiellement, ceux-ci se répètent et se déclinent sous de nombreuses modalités différentes au cours d’une journée de travail[6]. Par leur importance dispositive et leur récurrence, ils scandent donc l’expérience générale de l’enseignant qui, au contact de l’infrastructure scolaire, cherche à exécuter les tâches qui constituent la spécificité de sa profession[7].
Ensuite, suivant ce que l’on vient d’avancer sur la logique dispositive, pour que l’environnement de travail puisse être un lieu d’épanouissement, un lieu enchanteur, il faut qu’il soit un lieu « suffisamment bon », c’est-à-dire un lieu sécurisant, bienveillant et capable de fonctionner comme un « écrin expérientiel », un soutien, une promesse à la « possible expérience de la coïncidence entre l’intérieur et l’extérieur » (Belin, 2002, p. 223). Façonné, réalisé aux cours des expériences quotidiennes répétées selon cette douce et excitante oscillation entre la surprise et l’angoisse, un tel environnement se charge alors peu à peu de cette « magie » banale et ordinaire qui octroie au quotidien son sel et sa saveur — un environnement autorisant que l’on y déambule, que l’on puisse en son sein, « s’y fraye[r] sans s’y perdre » (Ibid.). Loin de ce qu’avance la théorie dispositionnaliste et sa (trop) mécanique (ad)équation entre des dispositions et un contexte propice aux expressions incorporées, le sentiment enchanté ne semble pouvoir émerger chez l’individu qu’au fil de l’eau ; il ne peut advenir qu’en se voyant tissé lentement, instauré par la rencontre entre l’individu et son milieu socio-matériel au creux — en creux — de l’expérience quotidienne. Ce serait donc dans l’éventuelle manipulation des données socio-matérielles qui constituent l’environnement direct des enseignants au travail que résiderait la possibilité d’ainsi constituer, à moyen terme, un support enchanteur à l’activité professionnelle ; ce serait au travers de la construction pratique d’une « niche » affectivement et cognitivement enrichissante et sécurisante, qu’un véritable ordinaire professionnel désangoissé pourrait émerger. Qu’il nous suffise, pour illustrer ce propos, d’imaginer la même scène que celle décrite en préambule de ce texte, mais avec une photocopieuse efficace à coup sûr. L’enchaînement des évènements décrits aurait alors été tout autre : le passage par la photocopieuse aurait peut-être été un moment d’échange, une sorte de « pause », propice aux échanges informels, entre la maîtresse de stage et sa stagiaire, permettant à la fois d’échanger sur les modalités de la prestation à venir de cette dernière et assurant aux deux partenaires l’adéquation de leurs perceptions sur celle-ci ; l’arrivée en classe avant la sonnerie de la fin de la récréation aurait pu permettre aux deux protagonistes d’organiser concrètement la classe (distribution des supports de cours, allumage du rétro-projecteur, réglage de la luminosité de la pièce, etc.) en amont de l’arrivée des élèves. Pour dire les choses simplement : si la photocopieuse avait fonctionné sans qu’on ait eu à s’en soucier, celle-ci aurait participé à agencer une expérience professionnelle fluide — et donc, potentiellement enchanteresse.
Enfin, la possibilité d’ainsi moduler son environnement direct dépend certes de la capacité « créative » de l’enseignant à « échafauder » des états affectifs et cognitifs désirables par la manipulation des éléments socio-matériels qui l’entoure (Saarinen et Krueger, 2022), mais également de facteurs hors de sa portée. Les conditions politiques et socio-matérielles réelles des écoles, dont la littérature sur le sujet rend d’ailleurs assez bien compte, en sont l’exemple le plus évident (Barrère, 2017 ; Farges, Guidi, et Métais, 2018 ; Garcia, 2023).
Un continuum d’enchantement
Puisque tous les enseignants ne sont pas professionnellement confrontés aux mêmes conditions de travail, ceux-ci ne sont pas non plus soutenus par leur environnement de la même manière. Aussi, leurs capacités à ainsi créer de l’ordinaire et en jouir dépend de nombreux facteurs écologiques — moins relatifs aux « dispositions » des individus, donc, qu’à l’environnement direct de travail et à la capacité modulatoire de ce dernier. Par conséquent, l’avènement d’un processus d’enchantement dans des conditions matérielles de travail délétères semble peu probable, voire compromis (voir Perez-Roux, 2006). La déambulation, l’excitant attrait de l’ordinaire, se voit en effet dans de telles conditions, empêché et aplati par l’angoisse, constante et jamais vraiment évitée. Ceci finit par conférer à l’expérience quotidienne une coloration particulièrement stressante et éprouvante. A contrario, dans les cas où tout est fait pour que l’enseignant puisse faire de son lieu de travail concret un ordinaire, un lieu « où vivre » (pour reprendre les termes de Winnicott) matériellement ajusté à ses besoins professionnels, un enchantement est possible, voire probable.
Ainsi, un continuum d’enchantement, fixé sur un axe défini par des enseignants « non enchantés » d’une part, et « totalement enchantés » d’autre part[8], et articulé à la capacité environnementale du lieu de travail à produire un support existentiel plus ou moins favorable au développement d’un sentiment de bonheur au travail, peut être hypothétiquement dégagé de ce qui vient d’être avancé. Un tel continuum serait sans doute un outil particulièrement fécond pour comprendre, à nouveaux frais, pourquoi certains enseignants se voient enchantés par la pratique de leur métier, alors que d’autres ne le sont pas.
Conclusion
J’ai tenté de montrer les limites de l’approche dispositionnaliste pour traiter de la question du malaise enseignant. Pour y remédier, j’ai proposé un travail de redéfinition et de circonscription de la notion d’enchantement. Ainsi, j’ai montré combien, loin des colorations exotiques que lui prêtent le plus souvent la littérature anthropologique sur le sujet, l’enchantement pouvait être considéré comme un processus existentiel nécessaire à la structuration du quotidien ; combien l’ordinaire — d’une activité professionnelle comme celle d’enseignant — était sous-tendu par la logique dispositive, c’est-à-dire par la considération du milieu socio-matériel comme « écrin expérientiel », nécessaire dans la lutte contre l’angoisse. Sans cette possibilité de déambulation au sein des dispositifs (quels qu’ils soient), l’enchantement, et donc la vie (professionnelle) sans angoisse, ne peut advenir.
Si les conditions du métier sont mauvaises, ces dernières ne se contentent donc pas de « désenchanter » les enseignants : elles les projettent dans un environnement potentiellement hostile d’un point de vue existentiel. Ce que créent ces conditions précaires — le contexte délétère pointé par une partie de la littérature sur le sujet (Barrère, 2007 ; Lantheaume et Hélou, 2008) — ce ne sont pas seulement des conditions de travail difficiles rentrant en contradiction, voire en opposition, avec certaines représentations initiales idéalisées du métier (cristallisées dans le terme de vocation) : c’est aussi, et surtout un ensemble de situations où le métier est rendu impossible, empêché, empêchant la fluence ordinaire, l’ordinarité de se faire et de se vivre.
En revanche, quand les conditions socio-matérielles sont favorables à l’émergence de boucles rétroactives positives d’un point de vue affectif et cognitif, alors se forge et se façonne, pour l’enseignant, la possibilité même d’un ordinaire. Cet ordinaire, conçu progressivement au travers d’une manipulation de la matérialité environnante fonctionne comme un support à l’activité et protège l’individu contre la menace existentielle d’une fracture de la fluence du vécu routinier. Dans ces cas, un enchantement est possible ; un sentiment de bonheur au travail est probable.
Le bonheur au travail des enseignants dépend donc aussi en partie des politiques économiques mises en place dans le secteur, puisque les dépenses publiques influencent nécessairement les conditions socio-matérielles initiales de leur activité.
Notes
[1] Sur les raisons de ce manque d’intérêt ethnographique pour les questions relatives à la réalité quotidienne de l’école, voir Levinson (1999). Sur le peu d’ethnographies portant spécifiquement sur la matérialité de l’école, voir De Meyer (2024).
[2] Dans certains travaux relatifs à l’importance des objets dans l’activité pédagogique des enseignants, la thématique est parfois effleurée (voir notamment Adé, Sève et Ria, 2010). De manière générale, elle est cependant rarement abordée de front (Lawrent, 2020).
[3] « Dispositions + contexte = pratique » (Lahire, 2021, p. 117).
[4] C’est d’ailleurs contre cette possibilité que la culture, au sens générique et ethnologique du terme, s’organise et cherche à lutter. De fait, à l’orée de l’ordinarité, juste en deçà de celle-ci, se trouve l’angoisse impensable (unthinkable anxiety) de l’annihilation de soi, le traumatisme potentiel de se voir, de se sentir, disparaître, ravalé complètement dans l’impersonnel (Tasia, 2025).
[5] En effet, originairement, l’espace potentiel est une zone intermédiaire entre un petit enfant — un être en devenir — et une « mère suffisamment bonne », c’est-à-dire un individu « favorisant l’intégration du moi, la personnalisation et la relation objectale » (Davis et Wallbridge, 2016, p. 181). Le rôle de cette « mère » étant bien de proposer un soutien à l’enfant, c’est-à-dire de répondre, d’une manière ou d’une autre, à tous les besoins de celui-ci.
[6] Comme le montre Philippe Perrenoud (1996) dans un ouvrage traitant de la complexité du métier d’enseignant, trouver des solutions à des situations du genre de celle décrite ici, « agir dans l’urgence » et « décider dans l’incertitude » fait partie du quotidien de ces professionnels de l’éducation.
[7] À cet égard, David Adé et ses collègues notent dans une étude portant sur l’importance des objets dans la mise en scène pédagogique d’un cours d’éducation physique, combien « [l]e caractère incertain et contraint de la manipulation des objets a été vécu comme angoissant par les enseignants stagiaires » (2010, p. 90) ; combien « [l]a gêne et le sentiment d’angoisse [peuvent être] vécus par les enseignants lors de la manipulation du matériel [scolaire] » (2010, p. 88).
[8] Les deux extrémités du continuum, c’est-à-dire l’enseignant « non-enchanté » ou « totalement enchanté » constituent sans doute, des cas limites et simplifiés ; ils fonctionnent ici comme des idéaux-type permettant l’exposé du propos.
Bibliographie
Adé D., Sève C., Ria L., 2010, « Le rôle des objets dans le développement professionnel des enseignants stagiaires d’éducation physique », Savoirs : revue internationale de recherches en éducation et formation des adultes, vol. 10, p. 77-91.
Balcou-Debussche M., 2007, « Rapports des enseignants aux formes de savoirs et à l’écriture vus à travers l’usage des photocopies à l’école », Revue française de pédagogie, vol. 161, p. 15 23.
Barrère A., 2017., Au cœur des malaises enseignants, Malakoff, Armand Colin.
Belin E., 2002., Une sociologie des espaces potentiels : logique dispositive et expérience ordinaire, Bruxelles, De Boeck Université.
Bourdieu P., 1980., Le sens pratique, Paris, Éditions de Minuit.
Bourdieu P., Chamboredon J.-C., Passeron J.-C., 1973, Le métier de sociologue : préalables épistémologiques, Paris, Mouton.
Bowker G., Leigh Star S., 2023, Arranger les choses : des conséquences de la classification, Paris, Éditions de l’EHESS.
Brahy R., Bourgeois C., Zaccaï-Reyners N., « Effervescence et enchantement : expérience intime, performance publique, mise en partage », EspacesTemps.net. En ligne : https://www.espacestemps.net/articles/effervescence-et-enchantement-experience-intime-performance-publique-mise-en-partage/
Brahy R. (dir.), 2023, L’enchantement qui revient, Paris, Hermann.
Davis M., Wallbridge D., 2016, Winnicott : introduction à son œuvre, Paris, PUF.
De Meyer M., 2024, Tachraft : écritures et ordre d’État dans une école de village au Maroc, Rennes, PUR.
Durkheim E., 2012 [1912], Les formes élémentaires de la vie religieuse : le système totémique en Australie, Paris, Presses Universitaires de France.
Farges G., Guidi P., Métais J., 2018, « Introduction. Saisir les transformations des conditions enseignantes dans leur diversité et leur complexité », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, vol.°17, p. 7-20.
Garcia S., 2023, Enseignants, de la vocation au désenchantement, Paris, Dispute.
Gavillet-Mentha F., 2011, Un métier désenchanté : parcours d’enseignants secondaires 1970-2010, Lausanne, Éd. Antipodes.
Halloy A., Servais V., 2014, « Enchanting Gods and Dolphins: A Cross-Cultural Analysis of Uncanny Encounters », Ethos, vol. 42, n° 4, p. 479-504.
Hutchins E., 1995, Cognition in the Wild, Massachusetts, The MIT Press.
Krueger J., 2015, « Musicing, materiality, and the emotional niche », Action, Criticism, and Theory for Music Education, vol. 14, n° 3, p. 43–62.
Lahire B., 2007, L’homme pluriel : les ressorts de l’action, Paris, Hachette.
———, 2018, « Avoir la vocation », Sciences sociales et sport, vol. 12, n° 2, p. 143.
———, 2021, L’interprétation sociologique des rêves, Paris, La Découverte.
Lantheaume F., Hélou C., 2008, La souffrance des enseignants : une sociologie pragmatique du travail enseignant, Paris, Presses universitaires de France.
Lawn M., Grosvenor I. (dir), 2005, Materialities of Schooling. Design, Technology, Objects, Routines, Oxford, Symposium Books.
Lawrent G., 2020, « School infrastructure as a predictor of teacher identity construction in Tanzania: The lesson from secondary education enactment policy », African Studies, vol. 79, n° 4, p. 409-427.
Levinson B., 1999, « Resituating the Place of Educational Discourse in Anthropology », American Anthropologist, vol. 101, n° 3, p. 594-604.
Olivier de Sardan J.-P., 2008, La rigueur du qualitatif : les contraintes empiriques de l’interprétation socio-anthropologique, Louvain-La-Neuve, Academia-Bruylant.
Perez-Roux T., 2006, « Les enseignants néo-titulaires à l’épreuve du métier : entre désenchantement et formes d’adaptation provisoires », Les Langues Modernes, vol. 3, p. 34-44.
Perrenoud P., 1996, Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude : savoirs et compétences dans un métier complexe, Paris, ESF.
Sørensen E., 2009, The Materiality of Learning, Cambridge, Cambridge University Press.
Saarinen J. A., Krueger J., 2022, « Making Space for Creativity : Niche Construction and the Artist’s Studio », Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 80, n° 3, p. 322-332.
Susswein R., Tasia E., 2020, « S’initier au merveilleux », EspaceTemps.net. En ligne : https://www.espacestemps.net/articles/sinitier-au-merveilleux/
Tasia E., 2023, « La place des Carmes ou l’expérience d’un enchantement ordinaire », in Roosen M., Anne Rondia, architecte et paysagiste, Liège, Groupe d’ateliers de recherche / École supérieure des Arts de la Ville de Liège, p. 241-248.
Tasia, E., 2025, « Du lieu où nous vivons (le plein) et de celui où nous ne vivons pas (le vide). Esquisse d’une théorie de l’enchantement de l’ordinaire à partir d’un exemple ethnographique sur l’aménagement du foyer », Sociologies et sociétés, Article soumis pour publication.
Weber M., 2017 [1905], L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Flammarion.
Winkin Y., 2001, « Propositions pour une anthropologie de l’enchantement », in Rasse P., Midol N., Triki F. (dir.), Unité-Diversité. Les identités culturelles dans le jeu de la mondialisation, Paris, L’Harmattan, p. 169-179.
Winnicott D., 1975, Jeu et réalité : l’espace potentiel, Paris, Gallimard.