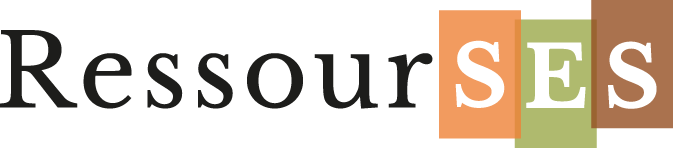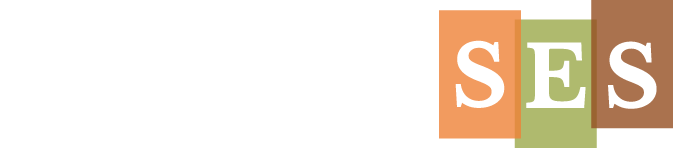Dans le langage commun, l’expression « travail » est souvent assimilée au travail rémunéré, légal, bref, à l’emploi. Or, n’est-ce pas dénier ce qualificatif au travail domestique, bénévole et scolaire ? Par ailleurs, faute de délimitation précise, son usage peut engendrer des anachronismes. Le mot ne s’impose en effet que tardivement dans notre vocabulaire et recouvre des activités qui, de l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge, étaient qualifiées de diverses manières, et non en un mot unique que nous utilisons aujourd’hui. Analyser la relation entre bonheur et travail nécessite donc un préalable : clarifier les termes du débat. Cet article a pour ambition de contribuer à éclairer le sens de l’un d’entre eux : le travail. À cette fin, il propose aux lecteurs d’envisager le travail comme une catégorie de pensée.
Philippe Connil
Professeur de SES
Introduction
Le « travail » est un mot si usuel et une expérience si commune dans notre société que ceux qui en parlent n’estiment pas nécessaire de définir le sens qu’ils lui accordent. Parce qu’il présente toutes les apparences de l’évidence, et parce que nous sommes censés avoir été, dès notre plus tendre enfance, habitués à considérer le travail comme une nécessité indiscutable et son absence comme la révélation d’un potentiel stigmate, le travail aurait une signification qui ne s’énonce pas, tant elle va de soi. Ce n’est pourtant pas le cas.
Le mot « travail » a une étymologie complexe et plusieurs hypothèses existent quant à son origine. Il serait apparu dans la langue française au XIe siècle, et viendrait du bas latin tripaliare, qui signifiait « torturer, tourmenter ». Mais cette étymologie qui associe le travail à une torture[1] est aujourd’hui contestée par de nombreux linguistes[2]. Ceux-ci privilégient une autre hypothèse, qui fait dériver le mot du latin trabs, signifiant « poutre ». Cette origine est liée à des mots comme travée et entraver, et évoque une notion de contrainte. Cette hypothèse semble confirmée par l’utilisation du mot « travail » pour désigner un dispositif servant à immobiliser les grands animaux (chevaux, bœufs) afin de pratiquer sur eux certaines opérations. Quoi qu’il en soit, du XIIe siècle jusqu’au XIVe siècle, le « travail » est associé à la souffrance, au tourment, à la fatigue, et en particulier, aux douleurs de l’accouchement. Ce n’est qu’à partir du XVIe siècle que le mot désigne une activité productive, et plus précisément « l’emploi » à la fin du XVIIIe siècle, signification qui deviendra dominante au fil de l’essor du salariat. Il recouvre alors les activités humaines qui satisfont une utilité sociale et qui sont rémunérées[3]. Cette évolution sémantique du mot « travail » rend compte de son caractère polysémique qui persiste aujourd’hui.
En effet, les individus n’accordent pas le même sens au mot « travail ». Le travail est perçu par les uns comme une source d’émancipation, d’autonomie, de réalisation de soi et parfois même défini comme tel. D’autres, au contraire, accusent le travail d’être une source d’aliénation, d’exploitation ou de souffrance.
De plus, certaines activités, en général non rémunérées, sont revendiquées par ceux ou celles qui les pratiquent comme un travail, alors que ce qualificatif leur était jusque-là dénié. Enfin, de récents travaux historiques (Jarrige, 2023) ont mis en évidence le rôle essentiel des animaux dans l’activité de production, de l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, et considèrent que l’on peut parler de «travail animal ». Bref, derrière l’apparente unité de sens du mot « travail » se déplie une diversité de situations et les frontières entre travail et non travail ne semblent pas définitivement figées, mais sont au contraire l’objet de luttes pour leur délimitation. Ces différents constats nous conduisent à envisager le travail comme une catégorie de pensée. Nous tenterons également de mettre en évidence la nature et les enjeux de ces luttes.
Le concept de travail se comprend mieux quand on fait l’histoire des usages qui en ont été faits à différentes époques et dans différentes sociétés. Ce sera l’objet de notre première partie. Nous nous interrogerons ensuite sur le caractère spécifiquement humain du travail. Enfin, nous proposerons d’envisager le travail comme une catégorie de pensée socialement construite.
Une sédimentation socio-historique du sens attribué au mot « travail »
Il serait vain de chercher dans les sociétés primitives des formes d’organisation sociale où l’être humain se réaliserait pleinement dans son travail. De nombreux travaux d’anthropologie économique montrent plutôt le caractère ethnocentrique de cette notion, absente dans nombre de sociétés tribales. Par exemple, « chez les Maenge d’Océanie, il n’existe pas de notion de « travail » comme telle, non plus que de mot distinct pour isoler les « activités productives » des autres comportements humains » (Chamoux, 1994, p. 61). Pour Marshall Sahlins (1972), non seulement, le travail n’est pas une catégorie de l’économie tribale, mais de surcroît, ce n’est pas par lui que se définit le statut social. Dans les sociétés primitives, les activités consacrées à la subsistance et que l’on catégoriserait aujourd’hui comme étant du travail y occupent une place circonscrite. Les besoins exprimés sont satisfaits en peu de temps et avec un minimum d’efforts. Les occidentaux souffriraient d’ethnocentrisme à vouloir considérer les sociétés primitives comme des sociétés de subsistance, condamnées à peiner « dans une perpétuelle disparité entre [leurs] besoins illimités et [leurs] moyens insuffisants » (Sahlins, 1972, p. 37). Pierre Clastres renforce l’analyse de Marshall Sahlins : « deux axiomes […] paraissent guider la marche de la civilisation occidentale, dès son aurore : le premier pose que la vraie société se déploie à l’ombre protectrice de l’État ; le second énonce un impératif catégorique : il faut travailler. Les Indiens ne consacraient effectivement que peu de temps à ce que l’on appelle le travail. Et ils ne mouraient pas de faim néanmoins » (Clastres, 1974, p. 164). Enfin, dans certaines de ces sociétés, la notion de travail est éclatée en plusieurs termes et quand on se tourne vers des sociétés qui paraissent avoir une définition très large du travail, on constate alors que le champ sémantique du terme déborde largement celui de la production. « Peut-on dire que le travail existe quand il n’est ni pensé, ni vécu comme tel ? » (Chamoux, 1994, p. 67).
De même, il n’existait pas, dans l’Antiquité européenne, de terme unique pour qualifier ce que nous nommons aujourd’hui « travail ». Jean-Pierre Vernant (1965) indique qu’il n’existe pas chez les Grecs de l’Antiquité une grande fonction humaine unifiée qui englobe tous les métiers. Le travail n’est pas perçu comme une activité générale, mais plutôt comme une série de tâches concrètes, chacune ayant sa propre finalité[4]. Par une analyse sémantique de textes grecs antiques, Raymond Descat (1986) montre qu’on y utilisait deux expressions traduites postérieurement par « travail » : d’une part, l’acte, ou ergon, qui désigne ce qui est fait, l’œuvre ou le résultat et d’autre part, l’effort, l’activité pénible ou ponos. Ni l’un ni l’autre ne font alors l’objet de mépris. Ce mépris « existe seulement si, à l’occasion et à cause du travail accompli, l’exécutant se trouve dépendre, momentanément ou de façon permanente, du bénéficiaire » (Aymard, 1948, p. 128). Les esclaves, choses de leur maître, ne sont pas libres. Les thètes, citoyens les plus pauvres contraints de louer à autrui leur service comme ouvriers agricoles ou comme mercenaires par exemple, rivalisent d’indignité avec les premiers : eux non plus ne sont pas libres, puisqu’ils aliènent leur liberté à cette occasion.
Tout comme dans les sociétés antiques, il n’existe pas dans les sociétés médiévales européennes un mot unique recouvrant toutes les significations que nous donnons aujourd’hui au travail. Trois termes sont utilisés dans le latin médiéval (jusqu’au XIIIe siècle) pour qualifier les activités que nous définirions aujourd’hui de travail. Dans les sources écrites dont disposent les historiens, le terme le plus fréquemment cité est Opus (œuvre). Il renvoie au processus de création, de fabrication et a une connotation plutôt positive. À l’inverse du second terme, Labor, qui qualifie la production par le travail, mais une production fruit d’un effort, d’une peine (Fossier, 2000). Les Laboratores désignent donc ceux qui peinent ou s’activent de manière pénible. Rappelons que dans l’imaginaire[5] féodal qui se met en place à partir du XIe siècle, les Laboratores constituent l’ordre inférieur de la société et ont pour fonction de subvenir aux besoins matériels des deux autres ordres, les Oratores (ceux qui prient) et les Bellatores (ceux qui combattent)[6]. Le troisième terme utilisé, en plus d’Opus et de Labor, est Servitium. Il concerne toutes les tâches que les individus doivent effectuer pour assurer leur propre subsistance. Il concerne aussi les corvées que les dépendants doivent effectuer pour le compte de leur seigneur, ainsi que les prélèvements fiscaux opérés sur leur travail. Le « travail » au Moyen Âge est tout autant méprisé que dans l’Antiquité dès lors qu’il manifeste une servitude à la nécessité ou envers autrui.
Trois moments marquants du processus d’unification
Selon Dominique Méda (2022), l’invention du travail dans son sens moderne, c’est-à-dire l’unification sous un même mot d’activités jugées jusque-là distinctes va s’opérer au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Sans prétendre avancer ici une explication globale de ce processus, on peut cependant avancer trois moments forts de ce processus d’unification.
Le premier moment a trait à l’influence de l’économie politique dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Pour Adam Smith (1776), le travail est au cœur de la création de richesses. Celui-ci part du postulat que le travail est une unité de mesure de la valeur des marchandises. Cela le conduit à se représenter le travail de manière abstraite, comme mesure de la valeur : le travail abstrait. Cela implique que le travail soit quantifiable et sécable, mais au prix du contenu concret des activités qu’il recouvre. Par ailleurs, il doit être détachable, c’est-à-dire qu’il puisse être dissocié du travailleur en faisant du premier une marchandise distincte du second, ce qui peut d’autant mieux se concevoir que l’on divise le procès de production en tâches simples et élémentaires, de sorte que celles-ci puissent être faites par n’importe qui. Le travail devient alors une abstraction, le temps en est sa mesure. Et le temps s’y prête, car au XVIIIe siècle, le temps moderne a remplacé le temps médiéval (Le Goff, 1977) : les horloges, alors largement diffusées, confèrent précision et uniformité de la mesure du temps, jusque-là indiquée par la hauteur du soleil, le son des cloches ou le rythme des marées.
Le deuxième moment correspond au grand mouvement de « libéralisation » du travail, fort bien décrit par Karl Polanyi (1944). Il s’agit de la création d’un marché du travail. Le capitalisme manufacturier qui se développe au XIXe siècle nécessite une discipline du travail, du fait de nouvelles contraintes techniques (emploi de machines) et de la nécessité de coordonner des tâches spécialisées au sein de la fabrique. Enfin, l’existence d’un marché du travail permet d’ajuster la quantité de travail à une production dont le volume doit s’adapter à une demande fluctuante. Pour cela, il faut qu’il y ait des individus qui soient en mesure (ou en nécessité) de vendre leur force de travail et de se soumettre à cette nouvelle discipline (Thompson, 2004). Pour y parvenir, il faut « désencastrer » le travail des multiples règles, usages, coutumes et traditions qui l’encadrent. En France, cela se traduit par la suppression des corporations[7] et l’interdiction de toute association ou coalition ouvrière[8]. Le contrat remplace la tutelle (seigneuriale, communautaire, corporatiste), le travail devient « libre », mais cette liberté ne l’est que par défaut. On le vend au jour le jour, sans certitude du lendemain, sans protection, sans statut. Le salariat était alors la condition la plus indigne, la plus incertaine et la plus misérable : « on était salarié lorsqu’on n’était rien et que l’on n’avait rien à échanger, hormis la force de ses bras » (Castel, 1995, p. 11).
L’institutionnalisation[9] du travail comme concept abstrait est notre troisième moment. Le travail devient progressivement au XIXe siècle un marqueur identitaire recouvrant une diversité de métiers, de professions ou d’emplois. Il acquiert une centralité dans les conflits sociaux et les débats politiques : face à la question sociale du paupérisme et à l’essor du mouvement ouvrier, l’État est sommé d’agir : le droit au travail est exigé puis affirmé pour la première fois en 1848 par la IIe République (mise en place des ateliers nationaux). Ce droit ne s’entend pas comme une obligation de résultat, mais comme une obligation de moyens : l’État doit mettre en œuvre une politique permettant à chacun d’obtenir un emploi et de porter assistance aux chômeurs.
La notion générale de travail n’est donc ni universelle, ni indépendante des représentations passées. Nous avons considéré jusque-là le travail comme activité spécifiquement humaine, est-il concevable d’étendre cette notion aux animaux ? La catégorie de pensée « travail » englobe-t-il la contribution des animaux aux activités productives ?
Le travail est-il l’essence exclusive de l’être humain ?
Dans L’idéologie allemande, Karl Marx et Friedrich Engels affirment que les êtres humains « commencent à se distinguer des animaux dès qu’ils commencent à produire leurs moyens d’existences » (Marx, Engels, 1846, p. 15). Avant de se singulariser des animaux par la religion, la politique ou l’art, l’être humain marque essentiellement sa différence par le travail. C’est son « activité vitale consciente » qui « distingue directement l’homme de l’activité vitale de l’animal » (Marx, 1972, p. 58). « Ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais architecte de l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche » (Marx, 1867, IIIe section, chapitre VII, I. Production de valeur d’usage). Par le truchement du travail, l’être humain s’éloigne de sa condition primitive, il s’humanise, et en façonnant des forces et des idées nouvelles, il se transforme tout en transformant la nature.
Cet ancrage anthropologique est décisif pour toute la suite de l’œuvre de Marx. D’abord, il nous faut travailler et maîtriser notre travail pour être pleinement humains : dans le cadre d’un travail autodéterminé[10], c’est-à-dire aucunement entravé par des rapports de domination, qu’ils soient esclavagistes, féodaux ou capitalistes, l’être humain devrait par le travail exprimer ses aptitudes personnelles. Dans ce cadre, le travail permettrait à l’être humain « de s’exprimer en tant que tel, et de trouver dans cette expression de soi la certitude de sa propre valeur et de sa dignité » (Roza, 2024, p. 26). De ce travail, l’être humain devrait obtenir le sentiment d’accomplissement, une plénitude tirée de la réalisation de soi, à la condition, rappelons-le, que ce travail soit autodéterminé (Honneth, 2006). Tel il devrait l’être dans une société communiste, dans laquelle le travail serait une activité attractive, une « liberté réelle » et une « autoeffectuation du sujet », cette dernière expression signifiant que l’être humain se construit comme sujet humain par le travail (Marx, 1980, p. 101). « Dans la société communiste, personne n’est enfermé dans un cercle exclusif d’activités, et chacun peut se former dans n’importe quelle branche de son choix ; c’est la société qui règle la production générale, et qui me permet ainsi de faire aujourd’hui telle chose, demain telle autre chose, de chasser le matin, de pêcher l’après-midi, de m’occuper d’élevage le soir et de m’adonner à la critique après le repas, selon que j’en ai envie, sans jamais devenir chasseur, pêcheur, berger ou critique » (Marx, Engels, 1846, p. 165).
Cette conception ontologique du travail – le travail est l’essence même de l’être humain – permet à Karl Marx de mettre en évidence, par opposition, le caractère déshumanisant, contraint et aliénant du travail dans les rapports de production capitalistes : en vendant sa force de travail, le prolétaire se voit déposséder non seulement de son travail, de la liberté d’organiser à sa guise celui-ci, mais aussi des fruits de son travail, le capitaliste qui l’emploie se les appropriant. Il ne peut donc se réaliser dans son travail. L’activité de travail qui devrait exprimer l’émanation de son humanité et le libérer de son animalité devient au contraire, ici, celle qui l’y replonge.
Cette analyse marxiste du travail nous conduit à deux interrogations : d’abord, comment parvenir à la liberté du travail au sein d’une société marquée par une division poussée de celui-ci ? Émile Durkheim voit dans l’industrialisation des sociétés modernes l’essor de la division du travail. Les individus y occupent des rôles spécialisés et interdépendants. Cette spécialisation crée une complémentarité entre les membres de la société, qui deviennent dépendants les uns des autres pour satisfaire leurs besoins. Or, cette interdépendance, que Durkheim (1893) appelle solidarité organique, limite nécessairement la liberté de l’homme à s’adonner comme il l’entend à ses activités créatrices, autrement dit, à réaliser pleinement dans son travail ses potentialités. Comment parvenir à une telle liberté dans des sociétés où une division du travail est manifestement présente, quoique sous des formes diverses ?
La seconde interrogation a trait à la condition de l’existence d’une conscience chez l’être vivant pour que l’on puisse qualifier son activité de travail, ce qui conduit à dénier tout travail chez l’animal. Ne risque-t-on pas alors d’invisibiliser de la sorte la contribution des animaux à l’activité productive passée, contribution importante avant la mécanisation, en particulier à des activités agricoles ?
Dans les manuels d’économie contemporains, le travail est un facteur de production, au même titre que le capital. Il désigne l’effort physique ou intellectuel que l’être humain mobilise dans la production de biens et services. Les animaux ne sont donc pas considérés comme faisant partie du facteur travail : parce qu’ils ne participent pas volontairement à cette production, ne reçoivent pas de rémunération monétaire en contrepartie et, par ailleurs, parce qu’ils ne peuvent être considérés comme des agents économiques puisqu’ils sont incapables de prendre des décisions « rationnelles ».
Pourtant, François Jarrige considère que les animaux domestiques travaillent, eux aussi. D’une part, ils produisent des aliments : vers 10 000 ans avant J.-C., les chèvres, moutons et bœufs furent domestiqués pour leur lait, leur viande et leur force de traction. D’autre part, les humains les utilisèrent comme moyens de transport : dès l’Antiquité, les caravanes de chameaux permettaient le commerce de l’Afrique à l’Asie centrale, et notamment sur la route de la soie. Ils le furent aussi comme moyens de traction : au Moyen Âge, les animaux de trait, comme les chevaux et les bœufs, jouèrent un rôle essentiel dans les économies rurales et les chevaux et ânes furent utilisés dans les mines pour extraire des minerais. Enfin, au XIXe siècle, les animaux jouaient un rôle central dans les manèges, servant de moteurs pour actionner diverses machines et équipements. Ces animaux, souvent des chevaux, des bœufs, des mulets, et parfois des chiens, étaient attachés à un mécanisme rotatif et effectuaient un mouvement circulaire continu pour produire de l’énergie (Jarrige, 2023).
Certes, nous pourrions considérer les animaux comme un capital productif, mais cela nous conduirait à les considérer comme des biens et à ignorer qu’il s’agit ici d’êtres vivants : au XIXe siècle, alors que le modèle de l’animal-machine était dominant, des voix s’élèvent pour affirmer que les animaux ne sont pas de simples objets dénués d’intelligence et de sensibilité. Se manifestent alors des préoccupations sur la condition animale, et la dénonciation de la souffrance animale se développe avec l’intensification de l’utilisation des animaux comme force motrice (Jarrige, 2023). Apprécier l’animal non plus comme un moyen mais comme un acteur du monde du travail soulève donc la question du statut de l’animal et de ses droits, et permet de penser la souffrance de l’animal au travail mais aussi son exploitation par l’homme. On peut donc affirmer que la qualification d’activités comme travail représente ici un enjeu éthique. Il s’agit aussi d’un enjeu propre aux sciences humaines puisque cette qualification remet en cause des catégorisations toutes faites entre nature et culture, humanité et animalité (Haraway, 2009).
Savoir qui travaille et dans quelle situation semble donc moins évident qu’il n’y paraît à première vue. Sur quels critères distinguer le travail du non travail ? Nous proposons d’envisager le travail comme une catégorie de pensée dont les frontières font l’objet de lutte pour leur délimitation.
Concevoir le « travail » comme une catégorie de la pensée et de la pratique
Une catégorie de pensée socialement construite
Dans son usage commun, l’extrême polysémie du mot « travail » explique sans doute pourquoi la substance même du travail nous échappe. Face à cette difficulté, Marie Anne Dujarier (2021) propose d’analyser le travail comme une catégorie de la pensée[11] et de la pratique : il s’agit de concevoir le concept de travail comme une représentation sociale contingente au contexte historique, social ou économique dans lequel on l’utilise et qui peut donc adopter des significations différentes selon ce contexte. Suivant l’analyse de Pierre Bourdieu (1993) au sujet de la famille, nous pourrions considérer le « travail » comme un principe de construction de la réalité sociale, principe de construction lui-même socialement construit. Partons de l’hypothèse que nous sommes aujourd’hui en présence d’une catégorie « travail » qui résulterait de la sédimentation de différents sens accordés au mot travail au fil des siècles. Selon quel principe, quels critères, délimiter le périmètre de cette catégorie ? « Comment choisir entre les définitions plus ou moins larges auxquelles nous faisons référence dans le langage courant lorsque nous parlons du travail ? » (Méda, 2022, p. 25).
Les frontières du travail au défi de la reconnaissance
Tout au long du XXe siècle s’est opéré dans notre société un processus de valorisation du travail qui renforce sa dimension morale. Pour Axel Honneth (2006), les individus ont des attentes morales. Les mobilisations et les luttes sociales ayant trait au travail ne visent pas seulement à obtenir des avantages matériels, elles sont aussi des « luttes pour la reconnaissance ». Dans la sphère collective, qu’il distingue de la sphère intime ou de celle des relations politiques et juridiques, l’individu doit pouvoir se sentir utile à la collectivité, il doit avoir le sentiment que l’on prend en considération sa contribution, en particulier par son travail. Celui-ci est d’autant plus valorisé qu’il lui procure la reconnaissance de la valeur sociale de ses aptitudes, ou plus précisément, le sentiment de se sentir considéré comme utile à la collectivité en lui apportant sa contribution.
Pourtant, à partir des années 1970, la montée du chômage et des emplois précaires, l’affaiblissement de l’Etat social et des protections collectives liées à l’organisation fordiste du travail fragilisent le statut salarial. La définition même du travail, héritée du modèle du travail salarié stable, est troublée et sa centralité dans notre civilisation interrogée (Castel, 1995). « Peut-être même sommes-nous sur le point de sortir de la « civilisation du travail » qui, depuis le XVIIIe siècle, a placé l’économie au poste de commandement et la production au fondement du développement social » (Castel, 1995, p.479). Est-ce pour cette raison que s’affirme alors dans le champ des sciences sociales un mouvement visant « à qualifier de travail un nombre croissant d’activités considérées jusqu’alors comme relevant de la générosité du partage, de la solidarité, du don, du plaisir de la création ou de l’engagement » (Albert et al. 2017, p. 7) ? Vont ainsi être forgées de nouvelles catégories de travail, citons-en quelques-unes : le travail domestique, le travail sexuel et reproductif, le travail bénévole, militant ou associatif, le travail créateur, artistique, sportif ou encore politique.
La définition du travail prend une dimension politique et cette extension peut s’expliquer par la volonté de rendre visibles des tâches dont l’utilité sociale n’est pas pleinement reconnue ou qui n’ont pas de visibilité dans l’espace public. « Qualifier une activité de travail permet aussi d’accéder aux luttes de classement du monde social » (Albert et al., 2017, p. 16). Ainsi, les mouvements féministes des années 1970 vont dénoncer l’exploitation patriarcale dont sont victimes les femmes en analysant les tâches domestiques comme du travail gratuit. Dans la famille conjugale traditionnelle, l’activité professionnelle de l’homme lui apporte une reconnaissance, ce qui n’est pas le cas de l’activité domestique des femmes, dont le travail est a contrario invisibilisé puisque non reconnu comme tel. « Il devient alors collectivement « évident » qu’une énorme masse de travail est effectuée gratuitement par les femmes, que ce travail est invisible, qu’il est réalisé non pas pour soi mais pour d’autres et toujours au nom de la nature, de l’amour ou du devoir maternel » (Kergoat, 2001, p. 37). De plus, les hommes bénéficieraient à la fois de la rémunération de leur activité professionnelle et de la gratuité du travail domestique qui rend possible leur investissement professionnel à plein temps. François de Singly (1987) affirme qu’un homme marié a plus de chance qu’un homme célibataire de réussir une carrière professionnelle, car il peut, contrairement au second, se décharger des tâches domestiques et parentales sur sa conjointe. Ce serait exactement l’inverse pour les femmes.
En remettant en cause l’apparente naturalité de la catégorie travail et en en faisant l’objet d’un rapport de pouvoir, et plus précisément, un rapport d’exploitation du travail des femmes par les hommes, les mouvements féministes ont indéniablement contribué à transformer la définition du travail et à l’élargir à de nouvelles activités (non rémunérées, non marchandes, informelles, etc.). Mais cet élargissement suscite des désaccords et des débats : quand Carole Leigh propose le vocable de « sex work » ou « travail du sexe » en 1978, l’enjeu n’est pas seulement politique, à savoir lutter contre la stigmatisation de la prostitution et permettre la prise de conscience par une population hétérogène de ses intérêts communs afin qu’elle soit en mesure de se mobiliser pour les défendre (Leigh, 2011). L’enjeu est aussi éthique : considérer la prostitution comme un travail susceptible d’être réglementé et professionnalisé, n’est-ce pas aussi une façon de légitimer la marchandisation du corps humain ?
Les frontières du travail rémunéré au défi du management et des nouvelles technologies
Les frontières qui séparent le temps consacré aux activités professionnelles et le temps consacré à soi (loisirs, sociabilité, repos), qu’on appelle depuis les années 1980 le temps libre, sont loin d’être étanches. Les nouvelles formes entrepreneuriales d’organisation du travail liées à la diffusion du néo-management[12] et des nouvelles technologies conduisent non seulement à la fragilisation des collectifs au travail, mais poussent aussi à l’abolition de ces frontières coutumières de l’existence individuelle. Or, ces dernières « protègent les personnes des abus coutumiers des « chefs », préservent le temps libre, la vie hors travail [professionnel], laissent les individus adhérer à une pluralité d’espaces de sociabilité, évitant ainsi d’en faire des êtres exclusivement dépendants d’une entreprise, d’un emploi, ou de la réussite d’un projet »[13].
La variabilité des horaires en fonction des besoins de l’entreprise et leur fractionnement au cours d’une journée désorganisent le temps libre et altèrent sa qualité. Les employés de l’hôtellerie, de la restauration, du nettoyage et de la grande distribution sont les catégories professionnelles particulièrement touchées par ce fractionnement. François-Xavier Deveter et Julie Valentin ont étudié celui-ci dans les emplois du nettoyage (2021). Les horaires de travail éclatés s’accompagnent d’une importante pénibilité physique et d’un manque de reconnaissance du travail. La fragmentation de leur temps de travail a pour effet pervers de supprimer les temps de pause habituellement intégrés dans le temps de travail quand il est continu. Selon les auteurs, la très forte externalisation de ces emplois serait moins une façon d’optimiser les coûts qu’un moyen de diminuer le volume de travail par l’intensification de celui-ci. Il en résulte une dégradation de la qualité du service fourni. Au sentiment d’un travail bâclé et à la pénibilité qui accompagne une forme de taylorisation des tâches s’ajoute l’invisibilisation de leur travail effectué généralement en absence des bénéficiaires du service rendu (public ou employés des lieux). Enfin, cette fragmentation rend souvent difficile la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle et peut limiter les interactions sociales et les possibilités de loisirs.
Ce qu’on appelle l’ubérisation de l’emploi[14] réactualise le tâcheronnat d’antan. Comme les « tâcherons » d’autrefois (ouvriers agricoles, bûcherons, ouvriers du bâtiment), les chauffeurs d’Uber ou les livreurs de Deliveroo sont rémunérés à la tâche (livraison, transport de particuliers) et ne disposent en France d’aucun contrat de travail puisqu’ils sont considérés comme des micro-entrepreneurs. Outre la grande précarité de leur travail[15], ces travailleurs ne sont pas libres de l’usage de leur temps non travaillé. En effet, durant la plage horaire qu’ils mettent à disposition des plateformes, ils doivent être disponibles à n’importe quel moment pour assurer les prestations demandées et peuvent perdre leur emploi dans le cas contraire. Une partie du temps quotidien des travailleurs des plateformes n’est donc pas libre sans qu’elle soit pour autant considérée comme du temps de travail, puisque ces travailleurs ne sont rémunérés que pour les « missions » accomplies.
Certaines entreprises proposent à leurs salariés des activités qui brouillent les frontières entre le travail et la vie privée. Elles peuvent, par exemple, leur offrir des installations de loisirs sur leur lieu de travail (salles de jeu vidéo, billards,…), ou organiser des événements sociaux (soirées festives, activités sportives collectives, week-end de team building), engendrant ainsi une confusion entre temps de travail et temps de loisirs. « Dans nombre de start-up, les jeunes salarié.es mènent une vie quelque peu confisquée où temps de travail et de loisirs sont confondus et orchestrés par le choix des dirigeant.es de mobiliser tout le monde en permanence » (Linhart, 2023, p. 52). Le télétravail a également des effets ambivalents sur le temps libre. Certes, il permet d’augmenter le temps libre en supprimant les trajets domicile-travail, d’avoir une plus grande liberté dans l’organisation de ses tâches et donc de son temps libre. Mais il rend aussi plus floue la frontière entre activité professionnelle et vie personnelle. L’imposition par l’employeur d’objectifs ambitieux sans délimitation précise du temps de travail accordé pour les atteindre peut contraindre certains télétravailleurs à prolonger leur temps de travail au détriment de leur temps libre.
Par conséquent, la frontière séparant le travail du non travail semble de moins en moins évidente. Elle l’est d’autant moins quand les individus coproduisent gratuitement les biens ou services qu’ils consomment.
La frontière séparant le travail de la consommation remise en question
Les consommateurs sont de plus en plus impliqués dans la production des services ou des biens qu’ils consomment. Certes, le phénomène n’est pas nouveau : le succès des grandes surfaces fut en partie basé par le remplacement du travail des vendeurs ou des vendeuses par le « libre-service » des consommateurs. Les entreprises de l’ameublement proposent des meubles bon marché en kit que doivent monter eux-mêmes les consommateurs. L’automatisation des tâches répétitives s’est élargie au-delà du secteur industriel pour investir celui des services, ce qui a accéléré ce changement. Le consommateur est incité à produire lui-même son billet de train ou d’avion, à facturer ses courses à une caisse automatique. Il est donc convié à coproduire les services en question, mais sans être rémunérés pour cela (Dujarier, 2009).
Plus discutable est l’appellation de digital labor[16] ou travail numérique pour désigner des activités numériques qui semblent pourtant relever de la sphère des loisirs ou correspondre à une consommation de services. « Faire une recherche sur Google, participer à un réseau social, poster une vidéo amateur ou encore utiliser une application mobile […] peuvent être appréhendés comme du travail en tant qu’elles participent à créer de la valeur pour les entreprises du net » (Broca, 2017, p. 135). Les données des usagers obtenues par ces entreprises sont utilisées pour construire des profils de consommateurs et sont vendues ou exploitées pour des publicités ciblées. De plus, les utilisateurs des plateformes comme Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok, créent du contenu (photos, vidéos, textes, etc.) qui attire d’autres utilisateurs et génère d’autres revenus publicitaires. Enfin, ces utilisateurs réaliseraient un travail invisible en contribuant à affiner les algorithmes d’apprentissage automatique ou à parfaire des systèmes d’intelligence artificielle. Sébastien Broca énonce plusieurs critiques sur cette étiquette « travail » appliquée à ces activités. Quand bien même les données collectées sur les utilisateurs seraient monétisées, « elles ne sont nullement le fruit de la volonté de l’internaute. […] On observe une disjonction entre la volonté du sujet et les fruits de son action » (Broca, 2017, p. 138). L’auteur considère que cette situation ne correspond pas à la définition moderne du travail en tant qu’activité volontaire d’un sujet. Toutefois, il s’interroge sur les conséquences des mutations technologiques sur la définition du travail comme activité humaine consciente. L’essor actuel de l’intelligence artificielle (IA) semble renforcer la pertinence de son questionnement : le travail ne risque-t-il pas d’être « conçu comme un simple input informationnel, venant nourrir des processus automatisés dont l’accomplissement concret échappe en partie à ceux qui les ont mis en place ? » (Broca, 2017, p. 138).
Conclusion
La reconnaissance d’une activité comme étant un travail fait donc l’objet de multiples enjeux. L’extension récente de la notion travail à de multiples activités invite les chercheurs à s’entendre sur une définition du travail communément acceptable. Certes, la tâche semble au premier abord difficile puisqu’elle semble exiger de tracer une frontière supposée objective entre les activités considérées comme travail et celles qui ne le sont pas. Toutefois, cette nécessité n’en est pas une si l’on considère qu’une telle définition résulte de conventions historiquement construites, dans une lutte entre différents acteurs qui aspirent à imposer leur propre conception. À cette fin, parler du travail comme une catégorie de pensée nous invite à interroger le caractère objectiviste de la définition tout en suggérant que notre rapport subjectif au travail – nous rend-il heureux ou pas par exemple – n’est pas indépendant des relations et des structures sociales dans lesquelles nous nous situons, que ce soit dans la sphère économique, politique ou domestique.
Notes
[1] Le tripalium désigne un instrument de torture à trois pieux.
[2] https://www.penserletravailautrement.fr/mf/2016/09/tripalium.html
[3] https://rdv-histoire.com/programme/nommer-le-travail
[4] La thèse initiée dès la fin du XIXe siècle, selon laquelle les Grecs de l’Antiquité auraient méprisé le travail est donc problématique, dès lors que l’on projette sur la période étudiée une catégorie de pensée, « le travail », qui n’avait alors pas cours.
[5] Imaginaire théorisé au début du XIe siècle par les évêques Adalbéron de Laon et Gérard de Cambrai.
[6] On lit, dans le chapitre II du Livre de la Genèse, avant le péché, après la création, que Dieu place Adam au Paradis pour qu’il y œuvre (Opus). Au chapitre III, après le péché, Adam et Eve sont chassés du Jardin d’Éden et condamnés au Labor. Il y a donc bien, dans cette représentation religieuse de l’activité humaine, une opposition claire entre les deux termes.
[7] Décret d’Allarde, 2 mars 1791.
[8] Loi Le Chapelier, 14 juin 1791.
[9] L’institutionnalisation est un processus par lequel une réalité sociale, quelle qu’elle soit, est en train de se faire jour au sein d’une société ou de l’un de ses groupes. Dit autrement, c’est un mécanisme au cours duquel ce qui n’était pas encore perçu comme existant par des agents sociaux prend peu à peu forme par et en leur présence, au travers de leurs activités mentales, de leurs discours et pratiques, et finit par se voir doté d’une extériorité, d’une force ou d’une consistance suffisantes à leurs yeux pour bénéficier du qualificatif de réalité (Encyclopédie Universalis, https://www.universalis.fr/encyclopedie/institutionnalisation/).
[10] L’Oxford English Dictionary (Simpson et Weiner, 1989) définit l’autodétermination comme étant la « détermination de l’esprit ou de la volonté d’une personne par elle-même envers un objet ».
[11] Selon Durkheim et Mauss (1903), les catégories de pensée ne sont pas des constructions savantes imposées par le théoricien situé en surplomb de la société, mais résultent de classifications socialement construites par des collectivités humaines, à partir de leur expérience matérielle.
[12] À partir du milieu des années 70 se développe un nouveau management qui renonce au principe fordiste de l’organisation hiérarchique du travail pour développer une nouvelle organisation en réseau, fondée sur l’initiative des acteurs et l’autonomie relative de leur travail, mais au prix de leur sécurité matérielle et psychologique. Sur ce point, voir Le nouvel esprit du capitalisme d’Ève Chiapello et Luc Boltanski (1999).
[13] https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/01/1046-le-neomanagement-engendre-la-souffrance-des-cadres-dans-lindifference-generale/
[14] L’ubérisation résulte du développement de l’activité des plateformes numériques, et plus précisément, des plateformes qui pratiquent le crowdsourcing (« sous-traitance par la foule »). Cet anglicisme signifie la réalisation de prestations par des intermédiaires considérés comme des sous-traitants indépendants.
[15] La moitié des inscrits sous ce statut ne déclare aucun chiffre d’affaires, et seulement 5% parviennent à dégager 5 000 euros par trimestre selon l’INSEE. Source : https://www.vie-publique.fr/fiches/270196-quest-ce-que-luberisation
[16] Sur la notion de digital labor, lire Casilli (2016).
Bibliographie
Albert A., Plumauzille C., Ville S., 2017, « Déplacer les frontières du travail », Tracés. Revue de Sciences humaines, vol. 32, p. 7-24.
Aymard A., 1948, « L’idée de travail dans la Grèce archaïque », Journal de psychologie normale et pathologique, vol.°41, p. 29-50.
Boltanski L., Chiapello E., 1999, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard.
Bourdieu P., 1993, « À propos de la famille comme catégorie réalisée », Actes de la recherche en sciences sociales,. vol. 100, p. 32-36.
Broca S., 2017, « Le digital labour, extension infinie ou fin du travail ? », Tracés. Revue de Sciences humaines, vol.°32, p. 133-144.
Casilli A., 2016, « Le digital labor : une question de société », INA Global. En ligne : http://www.inaglobal.fr/numerique/article/le-digital-labor-une-question-de-societe-8763
Castel R., 1995, Les métamorphoses de la question sociale, Une chronique du salariat, Paris, Fayard.
Castel R., 2009, La montée des incertitudes, Paris, Éditions du Seuil.
Chamoux M.-N., 1994, « Société avec et sans concept de travail », Sociologie du travail, vol. 36, p. 57-71.
Clastres P., 1974 (ed. 2011), La société contre l’État, Paris, Les Éditions de Minuit.
Descat R., 1986, L’Acte et l’Effort. Une idéologie du travail en Grèce ancienne (VIIIe– Ve siècle avant J.-C.), Besançon, Université de Franche-Comté.
De Singly F., 1987, Fortune et infortune de la femme mariée, sociologie de la vie conjugale, Paris, P.U.F.
Devetter F.-X., Valentin J., 2021, Deux millions de travailleurs et des poussières. L’avenir des emplois du nettoyage dans une société juste, Paris, Les Petits Matins.
Dujarier M.-A., 2009, « Quand consommer, c’est travailler », Idées économiques et sociales, vol. 158, p. 6-12.
Dujarier M.-A., 2021, Troubles dans le travail, sociologie d’une catégorie de pensée, Paris, P.U.F.
Dujarier M.-A., 2019, « Qu’est-ce que le travail ? », in Boursier P., Pelletier W. (dir.), Manuel indocile de sciences sociales, Paris, La Découverte, p. 822-831.
Durkheim É., 1893 (ed. 1986), De la division du travail social, Paris, P.U.F.
Durkheim É., Mauss M., 1903 (ed. 2017), De quelques formes primitives de classification. Contribution à l’étude des représentations collectives, Paris, P.U.F.
Haraway D., 2009, Des singes, des cyborgs et des femmes. La réinvention de la nature, Paris, Jacqueline Chambon.
Honneth A., 2006, La société du mépris, Paris, La Découverte.
Jarrige F., 2023, La ronde des bêtes, Le moteur et la fabrique de la modernité, Paris, La Découverte.
Kergoat D., 2001, « Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe », in Bisilliat J., Verschuur C., Genre et économie : un premier éclairage, Genève, Graduate Institute Publications, p. 78-88.
Leigh C., 2011, « Inventer le travail du sexe », in Nengeh Mensah M., Thiboutot C., Toupin L., Luttes XXX – inspirations du mouvement des travailleuses du sexe, Montréal, Remue-Ménage, p. 267-270.
Le Goff J., 1977, « Le temps du travail dans la « crise » du XIVe siècle : du temps médiéval au temps moderne », in Le Le Goff J., Pour un autre Moyen Âge, Paris, Gallimard, p. 66-79.
Linhart D., 2023, « Un temps libre marqué au fer rouge du travail », Mouvements, vol. 114, p. 43-53.
Marx K., Engels F., 1846 (ed. 1975), L’idéologie allemande, Tome I et II, Paris, Les Éditions sociales.
Marx K., 1972, Manuscrits de 1844. Economie politique et philosophie, Paris, Éditions sociales
Marx K., 1865 (ed. 1973), Salaire, prix et profit, Paris, Éditions sociales.
Marx K., 1980, Manuscrits de 1857-1858, dits « Grundrisse », Paris, Les Éditions sociales.
Marx K., 1867 (ed. 2016), Le Capital, Livre I, Paris, Les Éditions sociales.
Méda D., 2022, Le travail, Paris, P.U.F.
Polanyi K., 1944 (ed. 1983), La Grande Transformation, Aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris, Gallimard.
Renault E., 2011, « Comment Marx se réfère-t-il au travail et à la domination ? », in Actuel Marx, vol. 49, p. 15-31.
Rey A. (dir.), 2023, Dictionnaire culturel en langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert.
Roza S., 2024, Marx contre les GAFAM, le travail aliéné à l’heure du numérique, Paris, P.U.F.
Sahlins M., 1972, Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives, Paris, Gallimard.
Smith A., 1776 (ed. 1990), Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Paris, Éditions Gallimard.
Thompson E. P., 2004, Temps, discipline du travail et capitalisme industriel, Paris, La Fabrique éditions.
Vernant J.-P., 1965 (ed. 1996), Mythe et pensée chez les Grecs, Paris, La Découverte.
Vernant J.-P., 1956, « Aspects psychologiques du travail dans la Grèce ancienne », La Pensée, vol. 66, p. 80-84.