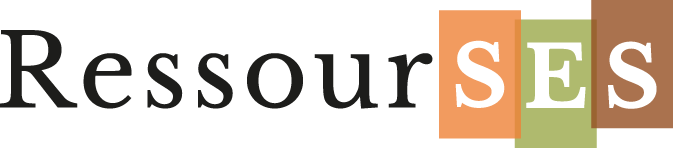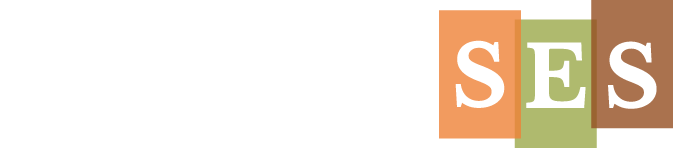Accès à l’exposition numérique : https://experiencesouvrieres.
Cette exposition digitale, accessible gratuitement en ligne, est le fruit du travail d’historiens et de sociologues dans le cadre d’un programme collectif de recherche. L’enquête a porté sur l’expérience ouvrière de la précarité au Japon, en France et en Belgique durant la période des Trente Glorieuses, et sur la Chine des années 1980 à aujourd’hui. L’exposition réunit une centaine de documents librement consultables par le visiteur qui permet de mieux saisir l’universalité de la condition ouvrière, par-delà les différences culturelles, géographiques et temporelles.
Gilles Guiheux
Professeur, Socio-histoire de la Chine, à l’Université Paris Cité, chercheur au Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA, UMR 245)
Cette exposition digitale, accessible gratuitement en ligne, est le fruit du travail d’historiens et de sociologues dans le cadre d’un programme collectif de recherche. L’enquête a porté sur l’expérience ouvrière de la précarité au Japon, en France et en Belgique durant la période des Trente Glorieuses, et sur la Chine des années 1980 à aujourd’hui. L’exposition réunit une centaine de documents librement consultables par le visiteur qui permet de mieux saisir l’universalité de la condition ouvrière, par-delà les différences culturelles, géographiques et temporelles.
L’exposition est née suite à un projet collectif conduit de 2016 à 2023, financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et conduit par Bernard Thomann, professeur à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco). Nommé Eurasemploi (https://eurasemploi.hypotheses.org), ce projet a réuni à l’origine dix chercheurs, à la fois historiens et sociologues, qui ont enquêté sur la condition ouvrière en Chine, au Japon et en France. Les résultats scientifiques de ce programme sont à paraître sous la forme d’un ouvrage (Thomann et Guiheux 2025). Le programme visait à élucider les liensentre la forte croissance économique et la transformation de l’insécurité du travail dans trois contextes distincts à deux périodes différentes : le boom de l’après-guerre en France et au Japon et les trois dernières décennies en Chine. Le projet, ambitieux, était donc comparatif en termes géographiques et chronologiques. Il visait notamment à savoir à quoi ressemble l’insécurité de l’emploi et de la vie en période de forte croissance ? Et, comment les différentes parties prenantes – les travailleurs, les syndicats, les institutions publiques, les représentants des entreprises –s’emparent de la question et contribuent à réduire l’insécurité. Au final, le projet propose une nouvelle vision, moins monolithique et moins glorieuse, des booms économiques de l’après-guerre, en établissant des parallèles avec la complexité de la situation chinoise. La démarche s’inscrit dans une série de travaux récents selon lesquels l’après-guerre jusqu’au milieu des années 1970 ne fut pas en France, ou au Japon, l’âge d’or trop souvent évoqué (Pessiset alii, 2013 ; Martigny 2025).
Alors que de nombreux travaux ont fait l’hypothèse que la Chine a suivi une trajectoire comparable à celle des économies capitalistes avancées, la perspective est ici inversepuisqu’il s’agit de repenser l’histoire sociale de la France et du Japon à partir de la situation chinoise, celle d’une classe ouvrière fragmentée. Si certains travailleurs bénéficient en effet de contrats à temps plein, d’autres sont employés à temps partiel ou sur une base temporaire. D’autres encore n’ont pas de contrat et sont payés à la tâche, en particulier dans le secteur des services, où sont créés la plupart des nouveaux emplois (Florence et Guiheux, 2023). Dans les décennies de l’après-guerre, la construction d’une société salariale en France et au Japon ne s’est pas traduite par une standardisation du travail salarié et une augmentation de la sécurité de l’emploi pour tous, ni par une quasi-disparition de l’insécurité.
Analysant comment la croissance économique rapide transforme la condition ouvrière dans ces trois contextes, l’exposition aide à penser les invariants du capitalisme. Le parti pris du dispositif est de laisser la parole à la richesse et à la diversité d’une centaine de documentsde natures variées : textes, images, vidéos, entretiens, archives orales. Certains de ses documents ont été produits par les employeurs, d’autres par des syndicats, des journalistes ou des experts qui conduisent des enquêtes, d’autres encore par les ouvriers eux-mêmes (textes biographiques, poèmes, chansons). Il s’agit d’annonces de recrutement, de rapports de chefs d’équipe, de comptes-rendus d’accidents ou de maladies. Ce sont des tracts syndicaux lors d’appels à la grève, d’articles de journaux, d’enquêtes conduites par les organisations ouvrières, de manuels de formation destinés à sensibiliser les ouvriers aux questions d’épargne, de santé ou de sécurité. Il s’agit aussi d’entretiens retranscrits – certains sont interprétés par des acteurs –, de spectacles enregistrés, ou de vidéos réalisés par des ouvriers eux-mêmes pour la partie la plus récente consacrée à la Chine.
Le site s’ouvre par cinq longs récits illustrés de documents visuels et sonores qui dressent le portrait de 4 figures : la fille d’un mineur polonais arrivé dans les corons des Hauts de France dans les années 1930, un immigré italien venu travailler dans les mines belges de charbon dans les années 1950, une ouvrière du textile shanghaienne des années 1960 à 1990, un mineur japonais des années 1960 et un ouvrier des petits ateliers familiaux du prêt à porter en Chine contemporaine. L’objectif poursuivi ici est d’incarner l’histoire sociale dans des personnages au destin tout à la fois particulier et représentatif de celui d’un groupe social.
Le site propose ensuite un montage permettant une pluralité de narrations et invite le visiteur à une immersion sensorielle au sein de trois grandes rubriques. Vies revient sur les trajectoires biographiques des ouvrières et des ouvriers, et en particulier sur la dimension migratoire de ces trajectoires. Corps évoque le processus de contrôle et de mise au travail des hommes et des femmes par le biais de la question des cadences, mais aussi des accidents ou de la surveillance dans les usines ou sur les lieux de vie. Luttes est consacré aux mobilisations collectives – grèves, pétitions, etc. – et aux pratiques culturelles – et observe comment l’identité ouvrière s’exprime dans l’écriture de poèmes, de chansons ou de pièces de théâtre.
Le visiteur, enseignant, étudiant ou élève, circule librement entre ces trois entrées. Les documents sont tous localisés et permettent aussi une visite en fonction des lieux où ils ont été récoltés, en France, au Japon ou en Chine. Chacun peut fabriquer une visite personnalisée en interrogeant l’ensemble des documents par mots-clés et archiver sa propre visite. L’enseignant peut donc sélectionner les documents sur lesquels il souhaite travailler ou demander à ses élèves de construire un cheminement à partir d’une thématique particulière (les budgets ouvriers, le logement, la santé, etc.). Pour aller plus loin, le site compte une bibliographie de référence et liste des archives consultées.
Bibliographie
Florence E., Guiheux G. (dir.), 2023, « Régimes de travail en Chine, Identités, institutions, agentivité », Le Mouvement social, vol. 285, n° 4. En ligne : https://shs.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2023-4?lang=fr
Martigny V. (dir.), 2025, Les Temps nouveaux. En finir avec la nostalgie des trente glorieuses, Paris, Seuil.
Pessis C., Topçu S., Bonneuil C. (dir.), 2013, Une autre histoire des « trente glorieuses », Paris, La Découverte.
Thomann B., Guiheux G. (dir.), 2025, Precariousness in High-Growth Economies. Comparing Labor in Contemporary China and in Postwar Japan and France, Amsterdam, Amsterdam University Press, à paraître.