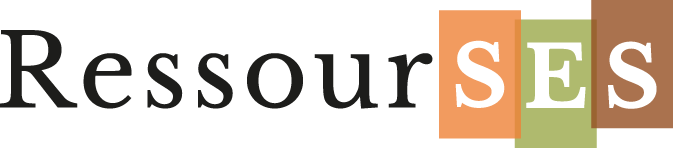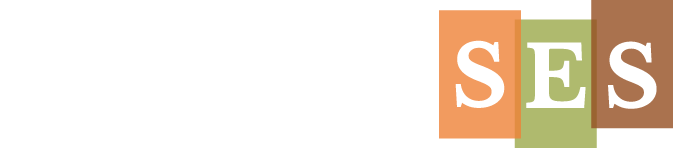Entretien réalisé par :
Erwan Le Nader, Professeur de sciences économiques et sociales • Université Paris Nanterre
Nicolas Postel, Université de Lille. Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSÉ)
Richard Sobel, Université de Lille. Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSÉ)
Erwan Le Nader : Vous avez récemment publié aux Presses Universitaires de France un « Que sais-je ? » consacré à Karl Polanyi. Pourquoi cet auteur vous semble-t-il un auteur important pour les sciences sociales ?
Nicolas Postel et Richard Sobel : Polanyi est un auteur essentiel aujourd’hui car il nous met en garde contre l’idée simple et fausse selon laquelle plus de marché, plus de libéralisme économique, cela amènerait nécessairement plus de liberté politique et une société apaisée et ouverte. Au contraire il démontre que la fragilité intrinsèque du capitalisme s’explique par sa tendance à faire s’effondrer la société, à la dissoudre et – finalement- à la conduire à se régénérer de manière maladive dans le totalitarisme. « C’est la réalité de marché qu’on perçoit dans le totalitarisme » … Voilà ce qu’il nous faut comprendre, au fond, tandis qu’il semblerait bien que nous soyons à nouveau à un moment de crise et d’effondrement liée à une phase libérale débridée.
Mais Polanyi est aussi un auteur essentiel pour des raisons théoriques et analytiques moins circonstancielles. C’est en tous cas cet aspect, souvent minoré lorsque l’on parle de cet auteur, que nous avons souhaité faire apparaitre dans notre ouvrage.
Son analyse nous pourrions la qualifier de syncrétique, au sens où il parvient à tenir « ensemble » 3 éléments centraux de ce que l’on peut qualifier d’économie politique institutionnaliste :
- Une définition de l’économique irréductible au marché. Polanyi définit en effet l’économie comme « procès institutionnalisé d’interaction entre l’homme et son environnement qui se traduit par la fourniture continue des moyens matériels permettant la satisfaction des besoins». C’est une définition essentielle et fondatrice d’une économie politique institutionnaliste qui se distingue de l’approche économique standard, d’origine néoclassique, et qui considère l’économie comme l’étude d’un individu désocialisé sous rationalité instrumentale (faisant de l’économie une branche de la logique). On peut souligner trois aspects. (a) Pour Polanyi il n’existe pas d’individu économique. Toute société fait face aux nécessités économiques – on ne peut s’en défiler – mais découvre et répond à cette question de manière immédiatement collective, socialisé, sous forme de process institutionnalisé. (b) La question économique est donc d’abord et immédiatement, pour toute société, la question écologique : comment se reproduire sans détruire l’environnement dans lequel (et duquel) on vit. Il écrit cela bien avant la « prise de conscience environnemental du monde occidental. (c) La question économique suppose qu’existe une détermination des « besoins » que la société considère comme avérés, par exemple après une délibération collective. Cette notion de besoin induit une limite sociale à l’identification des besoins de chacun. On est ici tout à fait en dehors d’une logique marchande qui se donnerait comme objectif de satisfaire au maximum les désirs, par essence illimités, de chacun. Ces trois points forment une infrastructure intellectuelle extrêmement solide, et malheureusement encore peu connue, de ce qu’est la question économique.
- Une définition des institutions fondamentales du capitalisme. Polanyi y parvient à partir d’une conceptualisation précise de ce qu’il qualifie de système de marché autorégulateur. Pour se déployer le capitalisme nécessite que l’outil de production soit alimenté en flux continu de facteurs de production. Il faut fluidifier ce qui coule vers la sphère productive et lui permet de décupler la production. C’est la condition de possibilité du capitalisme : terre, travail et monnaie doivent être traité « comme » des marchandises. Or, Polanyi précise qu’une marchandise est « ce qui est produit en vue d’être vendu ». Deux critères sont donc mobilisés : une marchandise est reproductible et sa production est légitimée et rythmée par l’existence d’un débouché marchand. Ce n’est évidemment pas le cas du travail, qui est un aspect de la vie humaine (sans doute l’un des plus important au moins quantitativement), ni de la Monnaie, structure institutionnelle régulée par une autorité politique, ni de la planète Terre, que nous n’avons pas produite. Donc le capitalisme suppose comme condition de traiter « comme » marchandise ce qui n’en est pas. C’est là que réside la tension principale inhérente au capitalisme. C’est que qui explique que le mythe du marché autorégulateur qui se met en place (selon Polanyi) à la fin du dix-huitième siècle se traduise par un épuisement de la société qui se trouve d’une certaine manière mise au service de l’accumulation productive… une relation inverse à ce que devrait être une économie « au service de la société ». Cette pression énorme qu’exerce le principe de marchandisation tend la société et dissout les espaces de sociabilité. Si elle n’est pas prise en charge, ce mythe du système de marché autorégulateur et des marchandises fictives mène à l’effondrement social. C’est pour Polanyi la contradiction inhérente au capitalisme qui scie la branche sur laquelle il repose. Et cela nous donne une explication centrale de ce que sont les institutions fondamentales du capitalisme : les rapports à la biosphère, au travail, à la monnaie doivent faire l’objet d’institutions protectrices qui les protège de la violence des rapports concurrentiel/marchand tout en assurant une cohérence systémique compatible avec le principe d’accumulation (sauf à sortir du capitalisme).
- Enfin Polanyi esquisse une théorie du changement institutionnel. Dans la lignée des théories pragmatistes de John Dewey (avec lequel il échange) Polanyi théorise l’existence d’un contre-mouvement à la marchandisation et au désencastrement de l’économie. Les acteurs résistent en défendant une vision socio-politique de ce qui doit être : comment devrait-on considérer la vie humaine, la biosphère, le support de valeur… contre l’absolutisme marchand. Ces luttes sociales signalent la capacité des acteurs à modifier les règles du jeu. C’est dans cette capacité à participer à la construction des règles du jeu que se joue la liberté humaine, la capacité démocratique, l’affirmation d’une humanité pleine et entière. Cette conception dynamique des processus institutionnels renouvelle fortement l’institutionnalisme, qui souffre souvent d’une forme de « structuralisme », sans pour autant considérer naïvement que seule la liberté compte et que tous les possibles sont en permanence ouverts aux acteurs. L’attention de Polanyi à cette dialectique règle/action en fait un trait d’union entre l’économie politique institutionnaliste et le pragmatisme. On retrouve dans les travaux plus récents de Herbert Simon, puis d’Elinor Ostrom cette dimension, qui était également présente chez John Roger Commons. Polanyi participe de cet institutionnalisme pragmatiste qui va renouveler fortement notre représentation de la dynamique des règles en liant l’acteur et l’institution. L’institution est dans l’acteur, tout autant que l’acteur est au fond au cœur de la dynamique des institutions.
Polanyi analyse les transformations économiques dans le temps long et notamment l’émergence du « marché autorégulateur ». Sa pensée se distingue-t-elle de ce que nous dit Karl Marx du développement du capitalisme ?
Polanyi, d’une certaine manière, n’apporte rien de fondamentalement neuf aux analyses qui ont fondées l’économie politique de David Ricardo (qui repère le lien entre épuisement des ressources naturelles et l’État stationnaire), de John Maynard Keynes (qui tire toutes les conséquences analytique – en terme d’emplois notamment – du caractère non neutre de la monnaie, qui est au fondement de notre économie monétaire de production et qui ne doit pas être livrée à une régulation marchande) ou aux analyses de Marx sur le travail. Mais il est en revanche le seul à articuler ces trois aspects centraux de ce que fait le capitalisme à la société. En ce sens il est beaucoup moins précis que Marx sur le travail, mais il est aussi beaucoup plus complet dans son analyse du lien entre capitalisme et société. C’est ce que note Nancy Fraser dans son article « Pourquoi deux Karl valent mieux qu’un » (2023). Par ailleurs, Polanyi propose une conception de l’économique qui ne se réduit pas au capitalisme marchand et fait apparaître une diversité de formes économiques (qui ont été très résilientes dans le temps long, bien plus que le capitalisme) : la réciprocité, la redistribution, le système domestique et le commerce… Ce sont des formes diverses de réponses à la question économique – cohérentes avec les organisations sociales (symétrique, centralisée, autarcique, aux marges) qui ont longtemps rythmé la reproduction de la vie humaine, sans provoquer de catastrophe climatique jusqu’à l’exceptionnalité – malheureuse- de la parenthèse que constitue pour Polanyi l’épisode du marché autorégulateur. Ces formes anciennes existent encore aujourd’hui même si elles sont marginalisées et délégitimées par la logique de marché. En ce sens Polanyi n’adhère pas à la vision téléologique de l’histoire qui caractérise l’approche marxiste. Le capitalisme n’était pas nécessaire, n’est pas un aboutissement et ne porte pas en germe le système communiste. La conception polanyienne de la dynamique institutionnelle laisse plus de place à l’action et la nouveauté. Les choses ne sont pas écrites d’avance. Les hommes font l’histoire, et, en fait, ils savent qu’ils la font !
Dans l’ouvrage, vous parlez, finalement, assez peu du concept d’encastrement, qui a pourtant essaimé dans diverses sciences sociales, notamment la sociologie économique. Pourquoi ce choix ?
C’est vrai que nous avons fait le choix de retenir ce qui nous semble analytiquement puissant et réutilisable. Ce n’est pas le cas du concept d’encastrement et de désencastrement selon nous, et, surtout, c’est un concept ambigu comme l’est celui de « grande » transformation. En effet il pourrait laisser accroire que l’économie peut effectivement se désencastrer et fonctionne effectivement – comme cela est décrit dans les manuels standards- comme un système qui s’autorégule spontanément. Polanyi ne pense pas cela, bien sûr. Le principe de marché autorégulateur est un principe d’ordre visant à plier terre, travail, monnaie aux nécessités productives en les traitant comme marchandise. Mais d’une part rien ne s’autorégule, et, surtout, rien ne se désencastre vraiment. Les fameux cercles du développement durable faisant apparaître la nécessité de croiser à nouveau les sphères économiques sociales et environnementales est de ce point de vue une représentation délirante du rapport entre l’économie, la société et la biosphère. Il n’y a pas d’économie productive en dehors de la biosphère, on ne s’en échappe pas ! Pas plus qu’on ne pourrait concevoir une économie hors société… bien sûr ! Ce que pointe Polanyi c’est la souffrance et les dégâts sociaux, bien réels, du mythe et de la pression à la marchandisation. La lecture qui en a été faite par Mark Granovetter (1973), réfutant le désencastrement réel de l’économie et soulignant la force des liens faibles qui perdurent, puis, finalement, l’encastrement social des marchés et des transactions, nous semble finalement bien moins découler d’une lecture de Polanyi que de la théorie de l’équilibre général et de cette représentation si particulière et « éthérée » du système de marchés. Enfin, en termes macroéconomiques, le couple désencastrement/ré-encastrement ne rend pas compte de cette imbrication permanente inhérente au processus institutionnel. Il y a double mouvement, dialectique, tension entre ce qui pousse à la concurrence désincarnée et ce qui résiste. C’est cette dialectique que nous cherchons à repérer, et plus particulièrement là où elle est fondatrice du capitalisme (lorsqu’elle concerne la terre, le travail et la monnaie). Polanyi est extrêmement précieux pour cela et pour le repérage des formes d’organisations efficace en économie (réciprocité, redistribution, système d’économie domestique, commerce) qui sont efficaces au sens où elles ne menacent pas – contrairement au mythe du marché autorégulateur – les conditions de vie humaines sur terre.
Polanyi remet en cause l’idée d’un « doux commerce ». Comment, pour lui, le libéralisme est-il à l’origine des fascismes européens de la première moitié du XXème siècle ?
C’est vrai, et c’est fondamental, Polanyi s’oppose frontalement à l’historiographie classique qui associe l’extension du marché et du libéralisme économique à l’extension de la démocratie et du libéralisme politique. Polanyi pense l’inverse. L’extension du libéralisme politique, de l’idée de marché autorégulateur qui devrait imposer ses « lois » à la société fait peser une menace existentielle sur nos sociétés. Pour Polanyi, nous le disions en introduction, « c’est la vérité d’une société de marché que l’on perçoit dans le totalitarisme ». En effet l’extension du dogme du marché autorégulateur qui renvoie chacun à la nécessité d’être performant et compétitif par rapport aux autres détruit la socialité. La mise en concurrence de tous contre tous dissout les espaces communs permettant de faire société et de trouver des compromis politique. Cette dissolution de la société, le symptôme en est le primat de la rationalité instrumentale (celle des économistes) contre toute forme de raison pratique (Polanyi, sur ce point, est très proche d’Hannah Arendt). Mais la société ne disparait jamais bien sûr, elle se reconstitue de manière dramatique, dysfonctionnelle : non plus par la raison commune, mais par le sang et la race. Quand on ne parvient plus à faire société par la raison politique, le totalitarisme s’impose. On tient là un résultat majeur de son analyse : la compréhension de l’émergence du nazisme en Europe dans les années trente, sur le terreau d’une société rendue exsangue par un libéralisme exacerbé. C’est évidemment aussi pour cette raison que les analyses de Polanyi nous parlent aujourd’hui ! Le moment est polanyien : comment ne pas voir que la cure de libéralisme économique effrénée que nous connaissons depuis quarante ans nourrit le populisme d’extrême droite partout dans le monde ?
Une précision tout de même, que les professeurs de SES apprécieront sans doute. Le marché autorégulateur c’est un système. Ce n’est pas le cas de toute forme de commerce. Dans la célèbre analyse de Montesquieu il n’est en fait pas question du marché autorégulateur mais de cette forme de commerce bien plus ancienne, régulée socialement, fondée sur l’échange direct, la connaissance, le « juste prix » (aujourd’hui nous dirions le circuit court, le commerce équitable, etc.) qui sont des formes alternatives à la concurrence généralisée et nécessairement anonyme qui caractérise le marché autorégulateur. Polanyi reconnait non seulement la très grande ancienneté, la résilience, l’efficacité propre de cette forme de marché-rencontre fondée sur l’échange et qui en ce sens renforce plutôt qu’elle ne détruit le lien social. Il fait une nette distinction entre le marché-rencontre (le commerce) et le marché-concurrence (le marché autorégulateur). On le sait grâce aux analyses néoclassique : dans un marché fondé sur la concurrence il faut que le prix ne dépende que de la concurrence et en aucun cas d’un contact entre acteurs ; les acteurs n’échangent donc pas avant que l’on soit à l’équilibre ! C’est une théorie du marché sans échange, sans contact… C’est ce mythe d’un équilibre spontané reposant sur des individus désocialisés qui est délétère lorsqu’il se met à gouverner la société.
Après les déstructurations consécutives à la prééminence du « marché autorégulateur », Polanyi voit à l’œuvre une « Grande transformation ». En quoi consiste-t-elle ?
Polanyi écrit La Grande Transformation en 1944,au sortir de la seconde guerre mondiale. C’est un écrit post-apocalyptique, après l’effondrement. Et il est très optimiste. Les terribles convulsions qu’a provoqué le mythe du marché autorégulateur nous ont instruit sur la nécessité de « démarchandiser » les trois marchandises fictives, de remettre l’économie au service de la société et non l’inverse. C’est la conviction de Polanyi. Il ne peut pas encore, en 1944, décrire les effets de cette prise de conscience, mais il annonce cette transformation en cours, de manière assez messianique : la société qui vient pratiquera d’une forme de ré-encastrement pour palier à une forme de «désencastrement» dont son livre explicite le processus historique et les fondements analytiques. Polanyi décrit ce que pourrait être la liberté dans une société complexe et formule ainsi ce que l’on pourrait qualifier de manifeste social-démocrate (au sens plein et engageant du terme, qui a depuis perdu de sa substance).
Cette grande transformation, on la perçoit en particulier dans le « système des banques centrales », qui culmine avec les accords de Bretton Woods. C’est une première victoire du contre-mouvement : la démarchandisation de la monnaie. Ces accords ont été précédés de peu par les prémisses d’un appel à la démarchandisation du travail : on peut dire en effet que ce mouvement démarre avec la déclaration de Philadelphie (qui relance l’OIT et annonce les compromis sociaux d’après-guerre) en mai 1944 (un mois avant Bretton Woods).
On a là les bases d’une lecture polanyienne de l’après-guerre et de ce que les théoriciens de la régulation qualifieront plus tard de régime d’accumulation fordiste, fondé sur un compromis social entre travail et capital. En termes polanyien, la démarchandisation de la monnaie permet une reterritorialisation des politiques économiques, une autonomie des états nations d’après-guerre qui vont tous, d’une manière ou d’une autre, établir un compromis entre prolongation du capitalisme et préservation de la vie des travailleurs. En France, cet État social procédera par toute une série d’éléments démarchandisant le rapport au travail : contrat à durée indéterminé (pilier du droit du travail et de ses institutions spécifiques comme le tribunal paritaire des prudhommes) ; salaire déconnecté du prix de marché mais découlant au contraire d’accords et conventions collectives (nationales ou spécifiques à chaque branche professionnelles), invention d’un droit au salaire maintenu en cas d’arrêt involontaire de l’activité (protection sociale contre la maladie, le chômage et la dépendance liée au grand âge), droit à l’éducation, à la santé et à une série de service publics dédiés aux salariés (de culture, de transport, d’énergie, de logement…), politique économique de croissance pour assurer le plein emploi… Il y a bel et bien là une grande transformation, qui, sur la base des bouleversements causés par le marché autorégulateur, reconstruit une société vivable.
Cette grande transformation est cependant à la fois incomplète et fragile. Incomplète, puisque ni la nature, ni le contenu du travail ne sont démarchandisés. D’une part, donc, le compromis social fordiste généralise un rapport taylorien au travail, conception homogénéisante et déshumanisante de l’activité productive qui signale que le travail reste marchandisé, même si les conditions d’accès à la force de travail – les conditions de l’emploi – sont fortement institutionnalisées. Cela formera dès la fin des années soixante une fragilité. Mais surtout, le compromis social fordiste prospère sur la base d’une exploitation décuplée des « ressources naturelles » et des peuples qui vivent sur les terres dont elles sont extraites ! Il n’assure une forme de paix social et de démocratie que pour certains : les occidentaux, et plus précisément les hommes. Pour les 4/5 de l’humanité les trente glorieuses, c’est l’horreur ! Et cette exploitation du monde nourrit et pour partie rend possible le compromis fordiste. En ce sens le processus de démarchandisation est incomplet et intrinsèquement instable.
Polanyi a bien vu, en 1944, et c’est remarquable, les prémisses du processus de démarchandisation à l’œuvre. Il a ensuite, dans son œuvre d’anthropologie économique, considérablement argumenté sur le caractère exceptionnel et non durable de l’idéologie du marché autorégulateur, dont le déploiement effondre la société. Il a sur ce plan été un analyste remarquable des régimes socio-démocrates fordistes bien qu’il ne les décrive que très peu. Mais il n’a cependant pas perçu – sans doute devrions nous dire « pas eu le temps de percevoir » – le caractère partiel de cette démarchandisation.
Votre ouvrage va au-delà d’un ouvrage de synthèse, puis que vous proposez aussi de penser, avec Polanyi, nos évolutions contemporaines. En quoi la grille l’analyse polanyienne vous paraît-elle pertinente pour saisir ces évolutions des dernières décennies ?
Nous n’avons pas voulu faire une synthèse de tout ce que dit Polanyi, qui est parfois contradictoire comme tous les auteurs, mais de son leg en termes de compréhension de notre système socio-économique. Nous ne prétendons pas – bien sûr – être les légataires universels de Polanyi, c’est un auteur complexe, confus parfois, avec des intuitions géniales et des contradictions. C’est un auteur qui entremêle des récits, des analyses de terrain et des conceptualisation théorique. Il est un des précurseurs de l’abduction en sciences sociales, très sensible à la manière dont ses analyses de terrain (y compris antiques) bouleversent ses représentations du fonctionnement de l’économie et de la société. Il pratique une boucle herméneutique entre ses terrains et ses représentations théoriques qui évoluent dans leur formulation. Notre effort d’interprétation et de synthèse tire un fil – solide pensons-nous – mais il n’est évidemment pas le seul. Ce fil c’est ce concept de marchandise fictive appliqué aux trois facteurs de production (et à eux seuls) : ce qui ne peut être considéré comme marchandise et qui pourtant doit être traité comme marchandise dans une optique capitaliste. Cette tension, nous pensons que c’est une formidable clé d’explication de ce qui nous arrive aujourd’hui. Et quelle sidération cela provoque ! Polanyi nous décille les yeux et nous permet de voir quelque chose de précis et de clair dans la décomposition avancée de nos démocraties et la manière dont elles se fracassent sur le mur du dérèglement écologique. Il est mort depuis 1964 mais Polanyi nous éclaire aujourd’hui encore et sans doute plus que jamais. C’est là la marque d’une théorie puissante en sciences sociales : elle se survit à elle-même.
Les années soixante-dix ont été en effet marquées par un puissant mouvement de remarchandisation. D’abord de la monnaie : le système de Bretton Wood entre en crise dès 1971 avec la fin de la convertibilité-or du dollar puis laisse place avec les accords de la Jamaïque en 1976 à un système de change flottant. La monnaie redevient marchandise avec l’extraordinaire développement des marchés financiers et de la tutelle qu’ils exercent progressivement de manière de plus en plus nette sur les États nations. Sur ce plan l’émergence des agences de notations privées, au service des détenteurs de capitaux, et leur influence sur les politiques publiques est sans doute l’effet le plus visible et spectaculaire de ce que Polanyi aurait qualifié de processus de remarchandisation de la monnaie. Ensuite, et dans la foulée, du travail : la mobilité renouvelée du capital, ainsi que la clôture de la phase de reconstruction/rattrapage des États européens conduit à une période durant laquelle la compétitivité-coût des entreprises est au cœur du système capitaliste. Les actionnaires enjoignent alors les managers à mettre en concurrence les différents lieux de production possible sur la base du principe d’une minimisation du coût de production salarial. Cette phase va d’abord bloquer la démarchandisation du travail (du rapport à l’emploi) dans l’occident, puis, au fil des années quatre-vingt à travers les « réformes » nécessaires, engager un processus de déconstruction du compromis social fordiste : flexibilisation de la forme d’emploi, individualisation salariale et logique de performance individuelle, recul des services publics et privatisation des grands fournisseurs d’infrastructure d’énergie, d’eau, de transport, marchandisation de la connaissance et de la culture… si l’État social résiste ici ou là, et davantage en France sans doute que dans d’autres pays occidentaux, il est affaibli et surtout délégitimé. Accusé d’être la source de tous les maux et …un frein majeur à la « compétitivité ». En termes polanyien le contre-mouvement de démarchandisation recule sous la nouvelle évidence de la nécessité de respecter les « lois » de la concurrence, c’est-à-dire celle du mythique marché autorégulateur.
Sur la terre, enfin, et de manière centrale, on constate aussi une marchandisation accrue du rapport à la biosphère. Ce rapport marchand il serait cependant inexact de considérer qu’il vient à rebours d’une démarchandisation. En effet, comme nous l’avons indiqué, la période fordiste se caractérise par une extractivisme débridé, sans régulation même marchande – c’est un temps de prédation. On peut à cette aune considérer que l’entrée dans l’idéologie du « développement durable » s’apparente à une marchandisation qui s’appuie principalement sur l’extension du régime de la propriété privée à la biosphère à partir des analyses de Coase et de son fameux théorème du choix social (1960) dont une des applications directes sera celle du marché des droits à polluer et du principe pollueur/payeur. L’ensemble des dispositifs envisagés vise à faire en sorte d’établir un juste prix pour les ressources naturelles (« prix » et « ressource » sont deux termes qui signalent le mécanisme de marchandisation) : prix carbone, principe de compensation, taxes liées aux activités polluantes… Le néolibéralisme compose un panorama complet de redéploiement des principes du marché autorégulateur dans les trois directions correspondant à la fourniture des moyens de production : capitaux, ressources humaines, ressources naturelles.
Cette remarchandisation se met en place d’autant plus facilement que le double mouvement que décrit Polanyi est lui-même engagé dans une critique virulente du compromis fordiste en raison de son caractère incomplet. La révolte étudiante de Mai 1968 dénonce des perspectives de travail revenant à « perdre sa vie à la gagner » et proclame qu’il est « interdit d’interdire » notamment dans le cadre de process de travail perçu comme aliénant. Elle s’associe à la dénonciation tiers-mondiste et écologique qui monte en puissance dès le début des années soixante-dix en pointant l’absence complète de « protection » de la nature contre les ravages de l’accumulation. Cela va se prolonger dans la recherche d’un nouveau compromis social à travers le mouvement du management participatif puis de la RSE qui, en quelque sorte, propose d’associer « flexibilité du travail » et « citoyenneté d’entreprise ». La RSE cependant ne tiendra pas ses promesses. Volant social du néolibéralisme elle ne sera jamais doté d’un pouvoir de régulation suffisant pour contrecarrer les décisions actionnariales fondées sur la maximisation des dividendes et donc la pression accrue d’une logique concurrentielle sur les marchandises fictives.
Vous concluez votre ouvrage par des préconisations sur ce que pourrait être une société post-croissance. Quelles sont les pistes qui vous paraissent les plus prometteuses en ce sens ?
Oui c’est une conclusion, une ouverture, et cela ne peut pas avoir le même statut que l’analyse de ce qui s’est passé ou de ce qui se passe. Mais Polanyi est un excellent appui dans le cadre de cet exercice prospectif car il ne nous enferme jamais dans l’idée d’un système fermé et est d’abord un penseur de la diversité des formes économiques. Or, ces formes, elles sont encore là, vivace et efficaces même si nos formes politiques et intellectuelles les méprisent et les invisibilisent.
Il reste une très grande dynamique et un attachement à l’économie domestique. L’investir, la rendre plus équitable sur le plan du genre (et tout est à faire en la matière !), plus démocratique, la préserver… C’est un premier enjeu qui est à rebours de l’idée du travailler plus pour gagner plus. Il est étrange que nos sociétés s’écartèlent entre ces deux slogans contradictoires : le plus important c’est la famille… et il faudrait toujours travailler plus !
Il reste une grande force à la forme de redistribution. Certes l’ascenseur social semble en panne, les secteurs publics sont en déshérence, la protection sociale est mise en crise. Mais 50 % des richesses produites chaque année sont encore socialisées en France[1]. C’est une formidable richesse, un point d’appui incomparable pour renverse la tendance et redonner vie au double mouvement. Reconquérir la fierté d’une forme économique plus efficace que la forme marchande concurrentielle car beaucoup plus résiliente… même si évidemment elle est moins rentable pour les actionnaires qui guettent le magot de la protection sociale avec une avidité que chacun peut presque physiquement ressentir.
La réciprocité enfin est de retour dans des alternatives extrêmement vivaces, au sein de l’économie sociale et solidaire, redynamisée par le mouvement des communs. Depuis la percée analytique et politique d’Ostrom et le retour de cette notion de commun, de très nombreuses expériences alternatives se montent, y compris au sein des entreprises capitalistes, pour percevoir autrement la production, rééquilibrer les pouvoirs dans les entreprises, compter autrement l’apport des travailleurs, de la nature, et s’assurer de leur reproduction (modèle CARE par exemple, cf. Rambaud, 2023). Il faut comprendre ces mouvements d’acteurs porteurs d’espoir qui réconcilient résilience, satisfaction des besoins et délibération démocratique. Ces formes émergentes, souvent dispersées ont besoin d’une politique publique qui les fédère, les consolide, sans limiter leur autonomie. Là aussi une bonne lecture de Polanyi devrait inspirer la décision publique : tant qu’à mener une politique de l’offre n’est-ce-pas cette offre résiliente, habilitante, et émancipatrice qu’il faudrait soutenir ? Les initiatives existent depuis les entreprises à mission, jusqu’aux différents labels B-corp ou bien encore à la Convention des entreprises pour le climat… sont-elles soutenues ?
Le commerce, porte aussi en lui un potentiel qui n’est qu’effleuré par les dispositifs de commerce équitable, de labellisation bio, ou de circuit court. La radicalité d’un recours au marché-rencontre, le déploiement, par exemple dans les marchés publics d’un protocole permettant de recourir aux producteurs locaux, engagés dans la transformation écologique, proposant une offre de production résiliente devrait pouvoir être soutenu. Il suffirait là aussi d’une volonté politique car l’engagement éthique des consommateurs existe mais ne peut s’exprimer dans les formes de marché-concurrence qui lui sont proposées.
Dernier point, pas le moindre, la politique publique suppose pour s’exercer une souveraineté monétaire. Cela suppose de modifier le cadre général dans lequel fonctionne la zone euro, par exemple, qui semble tout à fait dépendante du regard des marchés financiers. Se défaire de cette tutelle est indispensable au déploiement d’une politique publique de la démarchandisation telle qu’elle a été récemment évoquée. La démarchandisation de la monnaie, plus encore que celle du rapport au travail ou la nature car la monnaie est une pure construction institutionnelle, suppose un acte régalien. Un acte pas si inaccessible si on en juge les moments franchement keynésiens qu’a connu la politique monétaire ces dernières années… Une démarchandisation de la monnaie qui se joue, bien sûr, aussi sur le terrain avec le fleurissement des monnaies complémentaires dans les territoires, selon des formes plus ou moins résilientes selon l’intensité des liens « communautaires » qui y existent.
La démarchandisation du travail, du rapport à la biosphère, à la monnaie n’est donc pas un horizon mythique mais un mouvement qui d’une certaine manière est déjà à l’œuvre et suppose surtout un changement des politiques publiques encore inféodées au mythe d’une croissance forte et durable tirée par des marchés flexibles permettant d’établir des prix concurrentiels efficaces… toute une mythologie à déconstruire… en lisant Karl Polanyi !
Notes
[1] En 2024, d’après l’INSEE, les recettes publiques représentent 51,4% du PIB.
Bibliographie
Coase R., 1960, « The Problem of Social Cost », Journal of Law and Economics, vol. 3, p. 1–44.
Fraser N., 2023, « Why two Karls are better than one : Integrating Polanyi and Marx in a critical theory of the current crisis », in Rapic S. (dir.), Wege aus dem Kapitalismus ?, Seiten, Karl-Alber-Verlag.
Granovetter M. S., 1973, « The strength of weak ties », American Journal of Sociology, vol. 78, n° 6, p. 1360-1380.
Polanyi K., 1944, The great transformation, New York City, Farrar & Rinehart.
Polanyi K., Arensberg C. M., Pearson H. W. (dir.), 1957, Trade and markets in the early empires, Glencoe, The Free Press.
Rambaud A., 2023,« Comptabilité & Théorie de valeur. Pour une autre vision de l’écologisation de l’économie », Regards croisés sur l’économie, vol. 32, p. 70-79.