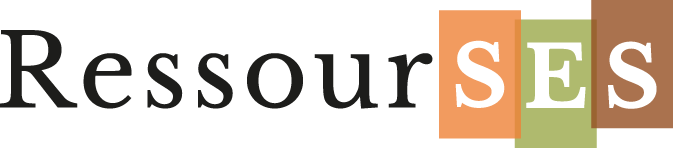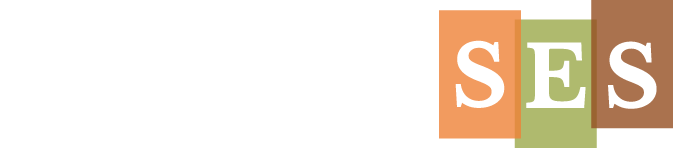L’ouvrage Jeunesses françaises contemporaines coordonné par Anja Durovic et Nicolas Duvoux est une pépite pour les professeur.es de Sciences Économiques et Sociales (SES). Il constitue d’une part une remarquable synthèse pluridisciplinaire de l’état de la recherche sur le sujet. Très accessible, il fourmille d’autre part de données récentes ainsi que de nombreuses références bibliographiques, classées par thème dont la plupart pourrait être utile aux enseignements que les professeur.es de SES délivrent : plus de la moitié des 10 chapitres de l’ouvrage dans lesquels ces thèmes s’insèrent porte en effet sur des questions en lien avec les programmes de SES.
Marianne Fischman
Professeure de SES
Le chapitre 1 de l’ouvrage explicite les difficultés à appréhender scientifiquement la jeunesse. Celles-ci seraient liées à sa diversité et au fait que l’insécurité sociale est particulièrement délétère pour les plus pauvres dont « la précarité s’apparente à un destin » (p. 31). La jeunesse a toutefois en commun l’allongement de cette période située entre l’enfance et l’âge adulte et le fait d’être marquée par sa dépendance vis à vis de la famille. L’autonomie et l’indépendance précoces acquises grâce aux diplômes étant valorisées par le modèle social français, les jeunes vivraient pour les auteur.es dans l’angoisse de ne pas parvenir à les obtenir.
L’importance du contexte familial pour les jeunes tient aussi selon eux au caractère élitiste du système éducatif français et aux inégalités précoces de réussite et de cursus scolaires allongés, décrits dans le chapitre 2. Celles-ci sont supérieures en France à celles d’autres pays de l‘OCDE et plus décisives qu’ailleurs en Europe. Les jeunes sont par conséquent « de plus en plus divisés, notamment autour du critère du diplôme » (p. 43). L’intensification de la compétition scolaire et l’extension de l’emprise de l’école pour accéder à l’emploi du fait de sa démocratisation et de sa massification, ainsi que les inégalités de l’offre et des ressources éducatives dont bénéficient les jeunes, ont généré une déception voire une « humiliation » et un « ressentiment » des « vaincus » (p. 49) qui peinent à se stabiliser professionnellement « dans un monde en crise(s) » (p. 73), alors même que près d’un.e lycéen.ne sur cinq travaille l’année scolaire sans être en alternance.
Ces constats débouchent sur un état des lieux inquiétant, présenté au chapitre 3, de la santé mentale dégradée des jeunes en France. Ils permettent aussi de comprendre tout au long des deux chapitres 4 et 5, la forte reproduction intergénérationnelle des inégalités en France et leur impact sur les conditions de vie et les trajectoires sociales des jeunes, avec un focus sur celleux de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le chapitre 4 éclaire aussi les transformations considérables de leur sexualité depuis le milieu du 20ème siècle, avec notamment l’affaiblissement de son lien avec la conjugalité et la procréation, et son entrée par le numérique plus que par l’information et l’éducation à l’école. Le chapitre 5 aborde également les discriminations subies par une partie de la jeunesse à cet âge de vie. On en retient que les choix des jeunes ne sont pas seulement contraints, comme le sont également ceux des autres classes d’âge. En France, les jeunes sont aujourd’hui « dans une situation très défavorable du point de vue des grands domaines de la vie sociale » (p. 19) et les écarts avec les autres dans ces domaines s’accroissent du fait des politiques publiques et des transformations de la société française. L’allongement de la scolarité, l’individualisation des parcours, la précarité accrue lors de l’entrée sur le marché du travail, la crise du logement, les transformations familiales et l’action indirecte, par la politique familiale, des pouvoirs publics envers la jeunesse, notamment en matière fiscale, font qu’aujourd’hui, en France, l’« entrée dans l’âge adulte est retardée et complexifiée » (p. 23). Cette « période à risque » où l’inégalité des ressources familiales joue à plein est de fait « une période mal couverte par la société » (p. 20). Elle se traduit « par de fortes inégalités entre les jeunes et les autres catégories d’âge et à l’intérieur de la jeunesse » (p. 83) et peut donner aux jeunes l’impression « d’avoir des destins entravés » (p. 74) tout en ressentant « une forte responsabilité dans leur propre destin » (p. 92).
D’autres facteurs expliquent ces inégalités, et notamment la diversité territoriale, objet du chapitre 6, avec tout d’abord, les jeunesses urbaines des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les parcours de vie y sont marqués par de forts « déterminismes sociaux et ethnoraciaux » (p. 150) qui éclairent les soulèvements dans ces quartiers. Viennent ensuite les jeunesses rurales, « fragmentées et polarisées » (p. 151), puis les jeunesses ultramarines. Selon les territoires concernés, 23 à 43 % des 18-34 ans qui en sont originaires viennent dans l’Hexagone (p. 157-158) pour y poursuivre des études et/ou occuper un emploi ; les jeunes qui restent sont donc plus souvent d’origine modeste, moins diplômés, au chômage et manquant de moyens. Pourtant, force est de constater les faiblesses, financières en particulier, et l’absence de cohérence des politiques de jeunesse (en dehors des politiques éducatives) en France. Ces inégalités aident à saisir les ressorts des violences des jeunes étudiées au chapitre 7 à partir d’enquêtes réalisées récemment. Celles-ci montrent que ces violences, minoritaires malgré l’augmentation du nombre de mineurs impliqués dans les homicides, sont exercées surtout entre pairs et parfois de manière collective, lors des révoltes contre l’autorité publique ou de rixes entre bandes. L’âge de sortie des bandes est d’ailleurs lui aussi de plus en plus tardif car ces dernières offrent « une assise « compensatoire » à la rudesse du monde social et à la désorganisation sociale » (p. 192). En cause, en effet, la vulnérabilité sociale, les comportements déviants, le genre et, surtout, la sortie du système scolaire ; le collège et le lycée constituant de ce point de vue des institutions protectrices.
Trois courts chapitres bouclent cet ouvrage.
Le chapitre 8 décrit le rapport des jeunes au numérique : presque 2 fois plus connectés au quotidien que la moyenne en France, les jeunes développent bien davantage sur les réseaux une socialisation entre pairs, plus qu’ils n’y trouvent « un levier pour l’engagement politique » (p. 203) ou n’y sont confrontés au phénomène de désinformation.
L’absence de reconnaissance des jeunes comme sujets ordinaires agissants est rappelée au chapitre 9 et conduit à insister sur l’importance démocratique de l’éducation des jeunes à la prise de décision et de la possibilité qu’ils puissent pleinement exercer leurs droits.
Finalement, le chapitre 10 analyse leur engagement politique. Celui-ci se caractérise par la montée de l’abstention, liée à « un rapport différencié au vote » (p. 219), distant et plus critique, « à la montée en puissance du vote intermittent » (p. 217) – chez les jeunes femmes en particulier – et « à un déficit d’offre politique » (p. 220). Mais il témoigne aussi d’un renouveau protestataire, particulièrement autour de l’écologie et de la solidarité, revendiquant un « sens commun partagé » (p. 222) soucieux de pluralisme et davantage enclin au patriotisme.
Construit en s’appuyant sur une approche comparative, cet ouvrage permet de spécifier la situation des jeunes en France, tout en en soulignant la diversité. Cette riche synthèse offre ainsi aux professeur.es de SES un regard très complet sur les jeunesses françaises contemporaines, utile non seulement pour les enseignements, mais aussi, du point de vue de la relation pédagogique, pour mieux saisir le vécu de leurs élèves. Enfin, elle constitue un rappel salutaire du rôle des institutions en général, et de l’école en particulier, pour aider nos élèves à devenir autonomes et à trouver leur place au sein de la société.